|
|
Revue d'Art et de Littérature, Musique - Espaces d'auteurs | [Forum] | [Contact e-mail] |
|
||||||
Première partie - Le roman est une hypothèse
|
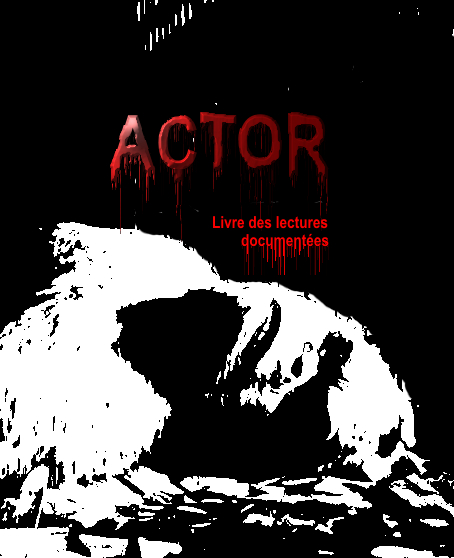
|
|||||
|
| Navigation | ||
 oOo I
Le roman est la cause d’un nombre considérable d’effets tant sur l’esprit que sur la communauté des esprits où il prend parfois racine jusqu’au mythe ou jusqu’à l’exemple. Jamais comme au siècle passé on avait tant réfléchi à la fois à sa raison d’être, à ses conditions d’existence et à ses structures. La production, suivant les fils d’Ariane de la mode, des excès, des contraintes et quelquefois des personnalités propres à en inventer la nouveauté, - pyramidale et titanique, a alimenté l’esprit jusqu’au besoin et peut-être même est-il question aujourd’hui de désir. Qui sait ?
Ce fut en tout cas un remarquable festin. Où en est-on ? Encore à table, certainement pas. Dans les antichambres de l’amour, doutons-en : trop d’hypothèses, pas assez de démonstrations. Et puis quelles différences entre les sociétés qui composent les entités civilisatrices ou qui se croient telles ! Il y a peu, l’Espagne publiait le remarquable "Madera de Boj", de Cela, un roman impensable en France. On découvre bien que Jelinek est franchement supérieure aux narrateurs éthiques du creuset parisien. Occasion d’ailleurs à ne pas manquer pour renaître littérairement avec la géniale Djuna Barnes. On se doute aussi qu’il est fort probable que le roman français est ailleurs et tout autre que ces piteuses tentatives de maquiller la pauvreté intellectuelle et les déficiences sentimentales en enquête policière ou en saga du terroir. Exercice retardataire de la rhétorique et nostalgie infantilisante des chronologies et autres généalogies explicatives des temps présents : barbarismes d’un langage qui mérite mieux que ces approximations un tantinet bonimenteuses. Faulkner avait pourtant résolu le problème des faits à évoquer afin de construire en toute cohérence l’idée même du roman à écrire et continuer d’exister avec son "explanation". Au fond, il n’y a qu’un problème, et c’est toujours le même : le goût, et ses prémices. D’ailleurs, plus on veut témoigner, dada des contemporains, moins on atteint l’expression romanesque - "Heureusement !" s’écrierait un magistrat. La poésie, par chance, mais aussi parce qu’elle est tellement différente de ses soeurs lamentables (ces chansons qui racontent comme des romans), la poésie tient le coup. Mais qu’en reste-t-il quand elle vient tout droit d’un roman sans prétention ?
De laboratoire du récit qu’il ne pouvait qu’être sous peine de n’être rien relativement à la littérature, le roman est devenu ce qu’il n’aurait jamais dû cessé d’être : une foire d’empoigne. Le problème, c’est qu’on ne s’empoigne plus avec talent. On glisse comme les ombres du marché qui fait exister au pignon de la rue le peu de littérature qu’on attend de soi et surtout des autres. Nous en sommes donc à des considérations structurelles qui n’ont plus rien à voir ni avec les récits ni avec les autres données du laboratoire ou de l’athanor secret des gens que nous sommes. Les lettres ont cédé le peu de place au livre et à son industrie. Le glissement s’opère donc vers les marges. On multiplie les occasions de le faire savoir, - qu’on glisse et dans le sens de la sortie, et il semble bien que ces soupapes de sécurité jouent leur rôle à merveille : jamais on a été aussi attaché à son emploi rendu précaire ou sécurisé au gré l’état et de ses entreprises nationales et privées. Dans ces conditions, le roman devient une babiole, pas une exigence littéraire.
Aussi est-on, chaque fois que le malheur frappe à notre porte pour nous pousser dans le jardin, en droit de penser qu’on est peut-être le martyr d’une cause. Pas de cause sans martyrs et pas de martyrs sans passé trouble. On écrit, disais-je, pour empêcher les autres d’écrire ou on écrit pour les oiseaux des branches. Je n’ignore pas quel langage sort de ces becs ni par quel artifice on les contraint à nous écouter un peu aussi. Question de technique. Mais il me semble que le peu de temps dont nous disposons avec tant de doctrine ne peut pas être gaspillé, même contre argent comptant ou à l’apparition féérique des indices flagrants de gloriole, avec des oiseaux au vocabulaire forcément limité. Quand on écrit, Messieurs les oiseaux, on écrit à des hommes et à des femmes, jamais à des enfants et on a prévenu les vieillards tremblants que leur époque est révolue. Bien entendu, les chefs-d’oeuvre demeurent et on n’en finit jamais avec eux parce qu’on n’a pas perdu la tête. "L’adieu aux armes" et "Absalom ! Absalom !" sont des histoires normales transformées en romans et ce n’est pas le contraire qui donnera raison aux charlatans en goguette !
II
Évidemment, de tels propos invitent à la démonstration. C’est qu’il ne faut pas confondre la colère et ses effets. Au moment d’avancer son propre jeu, on est plus mesuré, d’autant que ce jeu ne vaut peut-être pas la chandelle. Et c’est bien la question.
Il ne fait aucun doute que le faussaire en littérature est parfaitement conscient des données, des lois qui les composent et des figures fantasmagoriques qui en résultent comme la fumée de la pipe. Par contre, la sincérité, en mettant tout en oeuvre pour échapper à son silence (à son mutisme), prend un risque aux entournures : n’est-ce pas de l’opium qu’on est en train de fumer soi aussi ? C’est à cet endroit particulièrement délicat de sa peau de rhinocéros que le véritable romancier (écrivain) doit son éloignement, sa prudence, ses circonspections humides, ses coups de gueule, ses désirs ou mieux : son désir. Zone humaine en remplacement de cette galvaudée "condition humaine" qui fait long feu parce que c’est une ambulance et non pas une monture.
Car au fond, quelle aventure vivons-nous si nous ne la vivons pas avec les autres ? Est-ce vivre que de s’aventurer seul ? Les solitaires ont coutume de s’assembler sans constituer de sectes. C’est là leur défaut, leur fragilité, leur commencement de la fin. Se lisent-ils les uns les autres comme d’autres prétendent s’aimer ? J’en doute. On ne fait que passer et les autres continuent d’écrire parce que le désir est le même et qu’il n’y a peut-être qu’un seul désir à partager. On ne se nourrit guère de ces fragments d’un repas pris en commun, certes, mais sans perspective d’antichambre pour achever ce qu’on a commencé ou continuer ce qui n’a pas de fin. Et le goût règne en maître ; les classiques français, si loin de nous maintenant que la langue est fixée semble-t-il pour toujours, ne s’y sont guère trompés. Ils avaient accepté leur époque, leurs tyrans, leurs protecteurs diligents. Le poison coule dans nos veines, librement, depuis les philosophes. Et nous sommes restés des philosophes. Nous n’avons même pas la nostalgie de nos racines classiques. Quel classicisme en effet que celui qui ne concerna que les courtisans ! Notre belle nature de contemporain éclairé par les tubes cathodiques et les éclairages flous de nos centrales d’énergie nous confère toutefois une espèce de vraisemblance, sans doute parce que nous ne sommes pas convaincus par les convenances. D’où notre marginalisation tranquille, tranquillisée plutôt par des conditions d’existence de moins en moins précaires, menacé de suicide peut-être, ou de déroute mentale, mais écrivant à défaut d’apparaître comme des auteurs et, pourquoi pas, comme les auteurs de la littérature de notre temps (beau titre inaugurateur de la parabole d’Hemingway).
III
Eh bien le RENDEZ-VOUS DES FÉES est à la fois une enquête policière, avec son privé chapeauté et solitaire, et une saga des terroirs jumelés par les circonstances maritales ou au mieux conjugales (les Vermort à Castelpu en Pyrénées et les Alamos de Polopos dans la Sierra de Gador). Contrairement à CARABIN CARABAS qui est une espèce de brouillon monumental digne du XXe siècle considéré comme le promoteur du tout nouveau intérêt littéraire pour les documents de la vie, et qui limite sa résurgence mentale à un seul personnage qui se multiplie au lieu d’être le point centrifuge de l’écriture, le RENDEZ-VOUS DES FÉES semble plus achevé, plus propice aux personnages et par là à toutes les instances qui finissent par romancer ce qui au début n’était qu’une intention. Sa structure presque linéaire, les facilités de la langue qui cherche encore à couler de source car elle appartient (comment n’appartiendrait-elle pas à quelqu’un dans un de mes romans ?) aux personnages qui promeuvent l’action, la diversité de la documentation limitée à l’expression, le respect immobile des instances du récit, immobile et bavard, et enfin tout le gisement verbal découlant de ce qui a, historiquement, précédé le désir où nous sommes encore en cette fin de XXe siècle (eh oui !) - tout y est soigneusement, à rebours, imaginé pour ramener l’esprit aux conditions d’existence d’une époque qu’il faut bien considérer comme la première de celles que nous n’avons pas encore vécues jusqu’au bout.
Cette perspective historique qui construit ALIÈNE DU TEMPS, dont le RENDEZ-VOUS DES FÉES est le second volume, n’échappe pas aux personnages et il en est sans cesse question dans leur manière d’aborder le récit de leur présence au sein d’un roman. Certes, cette fois la narration ne se permet plus le montage abrupt qu’autorise notre époque aux auteurs des CARABIN CARABAS qui se proposent à l’esprit - plus, d’ailleurs, comme des mythes probables, à essayer avant d’en venir à des choses plus sérieuses, que comme des oeuvres dignes de figurer au cloaque des exemples à suivre. C’est à peine si des interruptions signalent des inachèvements plutôt inacceptables dans le cours d’un roman qui soit dit en passant (on s’en doute) n’appartient pas au siècle qu’il tente de subjuguer comme si c’était un personnage. Lecture relativement facile, ce qui est plus difficile à saisir, pour ceux que le saisissement mobilise aux dépens de tout ravissement, est l’ensemble, les relations de cause à effet, on sent la leçon de Cortázar, comme si elle était possible en un temps où elle n’eut pas lieu. Et ainsi, d’anecdotes en nouvelles, de tableaux en portraits, d’intrigues en aventures, le RENDEZ-VOUS DES FÉES s’installe dans un débat littéraire qui est effectivement le nôtre, ou plutôt celui qui devrait être le nôtre ou mieux encore, celui que je désire pour mon époque qui ignore, sachant ce qui a précédé et peut-être fondé le désir, ce qu’il en résultera à la fois pour l’esprit et pour l’existence à la fin de notre vie de patachons (pataches des fermes) ou de turlupins (nom de farce que prit un comédien).
IV
Mais je voulais en venir au roman lui-même. Avant les fées du XIXe siècle, et donc à une grande distance des carabins fous du XXe, le roman, malgré des dynamiques quelquefois déroutantes (Diderot) et des créations mythiques définitives (Rabelais et Cervantes), malgré les annonciations (Lafayette) et les protubérences (Scarron, Sorel), - le roman n’offrit jamais son flanc aux définitions lexicales. Il semble que les nouveaux maîtres de l’existence commune (les bourgeois), de Staël à Flaubert et de Flaubert à Huysmann (mais celui-ci annonçait déjà le fonctionnaire accroupi des temps à venir), - il semble qu’il leur est apparu essentiel, ou évident (choisissez votre temps philosophique), que le roman trouvât enfin ses lettres de noblesse, autrement dit son accomplissement littéraire incontestable. Quel labeur ! Et depuis, on a tout essayé. Certains même pensent aujourd’hui que le moment est venu de choisir. La panoplie semble complète. Il n’y aurait, dit-on en haut lieu, plus rien à découvrir et tout à parfaire, ou presque. Les maîtres des lieux seraient-ils sur le point de donner une conclusion à leurs recherches fébriles ? Serait-il vraiment devenu improbable, sinon impossible (la nuance doit avoir une importance), de soumettre sa propre vison des choses et du monde, pour tout dire de l’homme, à cette partie de l’humanité qui est la nôtre et pourquoi pas à ce reste qui en en est comme le résultat et qui, par reflet, laisse présager le pire ? Est-ce suicidaire de ne pas participer au perfectionnement au profit de l’invention qui gît, visiblement et non pas sans douleur, au fond de soi ?
À ces questions, on objectera qu’on a bien le droit de choisir et qu’il n’y a rien de vraiment blâmable à choisir judicieusement. La leçon commerciale, diffusée y compris dans les rangs des chômeurs, enseigne que le client est roi. Ce que le Roi veut, je le veux (et même je le donne à acheter). On est bel et bien dans l’antichambre du désir. Antichambre des créneaux à peupler d’oeuvrettes qui se donnent pour capter non pas l’héritage d’un lecteur qui mourra de toute façon ab intestat, laissant son humanité dans l’expectative (résurrection ou connerie des religions) mais pour plus prosaïquement détourner ses fonds. On en arrive à cette conclusion : il est toujours aussi difficile d’être écrivain que de chercher à le devenir.
V
Aux politiques commerciales conçues sur la base d’une doctrine toute échappée de la réalité des besoins réels et imaginaires, il faut bien, si l’on veut vivre, opposer des raisonnements susceptibles de donner lieu à la littérature. Un prix réel, un produit exactement décrit ou enveloppé dans sa substance fantasmagorique, des moyens de distribution équivalents à un rackett, et des outils de communication dont personne d’autre ne peut disposer, voilà ce qui fonde la force de vente. Avec de pareils moyens d’entreprise, on ne risque guère d’échouer dans sa tentative de capter les trésors enfouis ou plus exactement, la probabilité de dépasser le seuil de rentabilité est si proche de l’unité qu’on ne risque pas de passer son temps à se faire du mourron. - Le romancier ne dispose pas de cet arsenal. Sa vie est ailleurs. Et pourtant, c’est sur terre qu’il faut redescendre au moment de se livrer à une réflexion tangente sur le roman.
VI
Dès l’aurore du siècle passé, il est apparu évident que la fantaisie par exemple de Paul-Jean Toulet ne pourrait pas suffire aux exigences du moindre romancier capable de se nourrir de l’homme. C’est avec Jules Romain que les directives du roman (on pourrait les appeler aussi alternatives si elle se résumaient à un choix binaire) sont apparues avec toute la netteté, peut-être même la clarté, qu’on attend de l’inventeur ou du prévenu avant-gardiste qui promet et semble capable de tenir ses promesses. Le roman ne naissant à ce moment-là que du choix entre la société et l’individu, entre la mosaïque de Balzac et le héros romantique (romantique il l’est forcément à une ou deux nuances près), la proposition de reconstituer le monde par ses simultanéités pouvaient apparaître comme aussi pertinente que celle qui consiste, parallèlement, à préférer la doublure au personnage biographique. Que ce fût une caméra ou un autre moi qui écrivît, on innovait à coup sûr. Bien sûr, il y a loin entre la réussite de La recherche du temps perdu et les impiétés intellectuelles des Hommes de bonne volonté. Mais le ton était donné : on s’extrayait de la gangue romanesque tissée naguère par les documentations et les intropections, d’autant que lesdites documentations allaient être vite remplacées par des comparaisons et les introspections par des analyses plus délicates. Mieux, ou pire, la langue allait subir des outrages autrement efficaces, d’un point de vue romanesque, que les jeux de mots auxquels l’enfance avait habitué l’esprit. Et finalement, on toucha aux structures de toutes les compositions et de toutes les instances qui se présentait au jour de l’écriture. Le désordre qui en résulta faillit bien se terminer en tentative à mon avis avortée (mais c’est discutable) de devenir aussi classique que les Classiques, ce qui motive beaucoup mieux les probables inventeurs et les maîtres du style que les véritables fondements du récit, du dialogue, de la phrase et de tout ce qui peut servir à écrire des romans.
VII
Le plus souvent, celui ou celle qui veut écrire un roman est d’abord le créateur d’un personnage qui sert de fil conducteur et donc d’histoire. On voit à quel point on est ici éloigné autant de Romain que de Proust. Les variantes consistant à multiplier le personnage pour simuler un environnement n’ajoutent rien au principe. Je m’appelle Ismaël. Mettons. Suivent les péripéties de l’aventure coloniale ou conjugale, peu importe. La littérature est bourrée de pareils individus comme les organes de l’oeuvre taxidermiste sont remplacés par de la paille. - Quelques auteurs doués de plus de souffle ont animés des représentations du monde non pas en se contentant de multiplier le personnage-héros, mais en amenant le lecteur à traverser avec eux les lieux de ce monde en perpétuelle métamorphose. Ici, la documentation est celle de l’oeil. Il semble bien, à constater la perdition nautique de Sartre, que Dos Passos ait atteint les limites du procédé. Une variante probable de ce concert d’observations est la saga mais personne n’a trouvé ni le ton ni le mode avec la maîtrise que William Faulkner a imaginée dès ses premiers pas de nourrisson. - On ne voit plus guère de monde en mosaïque dans les romans du siècle, sauf dans les séries policières, encore qu’ici les croisements relèvent plutôt de la nécessité que de l’objectivité. Ce n’est pas que le modèle est insurpassable mais ni l’effort d’imagination ni la cécité du voyage n’attire les prétendants à la réalité faite texte. - Comme on le voit maintenant, le choix est difficile, pour ne pas dire périlleux. Quoi qu’on choisisse comme méthode d’illustration de sa capacité à écrire des romans, on se heurte à des maîtrises, et même quelquefois à des manisfestations du génie telles que le découragement est le premier symptôme de la maladie qui nous guette si nous n’avons rien, ni au mental ni en amour, pour pallier nos défauts de cuirasse. Or, il est bien connu que l’écrivain est rarement aussi dans son assiette que le commun des mortels (si on peut appeler ça comme ça) et que sa vie sentimentale est plus souvent un désastre que la base du bonheur de ses enfants. C’est donc ailleurs que dans ce choix gordien qu’il faut exercer sa perspicacité.
VIII
Il y a les instances du texte. Les jeux possibles sont infinis mais si limités en évidences esthétiques que la réflexion nécessaire à une résolution du problème peut coûter cher en temps et donc en croissance sociale. On peut jouer avec l’existence même du personnage, aller jusqu’à le supprimer ou au contraire le multiplier jusqu’à l’incohérence. On peut mettre des choses à la place du personnage ou des personnages à la place de ce qui n’existe pas encore. De cette expérimentation, on l’a lu, il ne ressort que l’arbitraire et, au fond, l’amertume de n’être pas aussi créateur que le créateur lui-même. - Les jeux avec le temps, au fond de je ne sais quel vortex aux expressions mathématiques, compliquent à ce point la patience (et non la lecture comme l’affirment certains) que le fer est trop vite porté au blanc et son trempage aussi illusoire que celui de l’épée Excalibur. Ce genre d’expérience n’est pas à conseiller à ceux qui, par nature, craignent les lendemains qui ne chantent pas. L’épreuve est finalement à la hauteur de la même chronologie soigneusement reconstituée dans sa linéarité et sa durée. Vanité. - Ah ! les lieux. Venise ! E tutti quanti. Toujours reconnaissable, on s’y exerce à la magie de l’évocation et de ce qu’elle est capable de trouer dans l’imagination ou la mémoire. Les mots de l’architecture, de la langue étrangère, des moeurs qu’on essaye sur le fil de son propre tranchant, les équivoques qui sont comme les tabulations du texte écrit, les rencontres fortuites, les explications historiques, etc. On n’en finirait pas d’explorer ces voyages de l’immobilité et du bruit. Et d’ailleurs rien ne s’achève jamais dans ce genre si particulier de la description et de l’inattendu. - Quant à l’écriture, si ce n’est d’ailleurs pas par elle que tout commence mais par ce qu’elle promet distraitement de contenir avec un peu d’exercice et beaucoup de chance, on y a tellement touché que la lassitude a remplacé l’enthousiasme des premières rencontres engageantes. Ici, on essaye plutôt de se faciliter les passages de l’idée à l’acte et on finit par se trouver un style reconnaissable ou en tout cas probablement en concordance avec ce qu’on attend, soi et les autres, de soi et des autres. Le style achève son existence dans l’imitation du ton qu’on prend quand on adresse aux autres sa supplique. Il ne survit guère longtemps à l’existence de ces autres pour qui on s’est, toute une vie, ou le temps d’un succès, décarcassé en état peut-être de sous-alimentation sentimentale. Brrrr...
IX
Les grands romans, ceux qui sont restés malgré l’outrage aux apparences qui semble constituer notre seule exigence d’actualité, se détachent nettement du chyle historique et demeurent non plus des points de référence mais l’occasion de contempler de véritables réussites de l’exercice littéraire. On les lit rarement mais on en connaît la substance, souvent par l’épisode particulièrement bien dessiné ou par la rencontre savamment fortuite d’un personnage porteur de toutes les illusions. Ils se sont incrustés dans les méthodes d’éducation des enfants et servent de garde-fous à des prétentions pédagogiques malmenées entre la nécessité d’instruire (science) et celle de discipliner (société). On connaît certes moins l’oison merdeux de Gargantua que les moulins de don Quijote mais le retour d’Ulysse s’empreint enfin de sueurs sexuelles et Lolita n’est même plus évoqué dans les procès faits aux pédophiles. C’est par une maîtrise crispée de l’enseignement et de la divulgation que, petit à petit, une culture s’incise prudemment pour s’incruster les joyaux élémentaires de ses activités marginales et apparaître finalement comme le chaton idéal, ce qui ne manque pas de donner lieu aux prémices de la guerre (USA), à l’esquive de l’égalité (France) ou au meurtre des bouffons (pauvre Arabie).
Les premiers de ces romans (écrits en vers ou en prose, là n’est plus heureusement la question), sans être eux-mêmes des allégories, en sont le lit rapide et l’alluvion définitif. C’est à l’occasion de pures pratiques littéraires que naissent quelquefois les mythes qu’on accroche à nos sensibles extrémités et à nos profondeurs indécises. Ici, le mythe arrive plus souvent par le biais du désir que sur les rails de l’intention. On ne connaît pas d’exemple d’un texte créé tout exprès pour mythifier qui ait réussi à franchir la mort de sa génération. Nos sociétés, débarrassées des dieux en faveur d’un seul choisi au hasard des disputes historiques et des combats politiques (Jésus, Allah), range les mythes dans les casiers de sa conscience et non pas dans ceux de sa mémoire. Une espèce de perfectionnement, sans acharnement, procède aux derniers réglages et corrige les sécrétions indésirables pour en orienter le jet de sang vers d’autres horizons, comme ceux proposés par la solitude. À l’heure de s’approcher de ces quarantenaires censés habiter des tours d’ivoire, le réceptacle des sensations et des facilités intellectuelles se remplit de nouvelles versions de la maladie mentale et le débat des psychoses reprend toute son ampleur et ses couleurs d’enfer. Ceci pour dire que la mythification des oeuvres dénature l’écriture au profit des usages éducatifs et judiciaires. Mais enfin, l’oeuvre demeure en principe intacte et rien n’interdit de s’y plonger si on en trouve le temps. Encore heureux !
La deuxième catégorie de romans qui perdurent malgré les changements en tous genres est réservée à l’élite (qui n’est pas dispensée de l’exercice du mythe). En effet, on ne désosse pas Dominique aussi facilement qu’Ubu. D’ailleurs, ce genre de travail au texte ne se répand pas et ne sert pas à expliquer et à diriger les pas. Le roman-photo ne descend pas du roman d’analyse mais des marges du mythe où la vie continue. Le cadre du roman d’analyse, quand il est réussi, est à ce point étroit qu’on ne peut guère envisager d’y voyager et d’en revenir avec un excédent de bagage. Les tragédies de Racine, dont l’ensemble forme d’ailleurs le plus remarquable "roman" écrit en cette période de l’humanité, ne tolère aucune mise en scène parallèle et renvoie sans cesse ses interprètes à l’école de la diction et de l’expression corporelle. Les approximations du music-hall n’y changeront rien. Bien sûr, Dominique et Adolphe sont plus proches de nous, non pas sur le segment de temps où nous apparaissons nous aussi, mais mentalement, à côté de nos propres personnages, souvent des proches, dont nous dressons quotidiennement la caricature pour la frotter à ces exemples croissants de perfection analytique. C’est ici que le mot personnage prend son sens en regard de l’entité qui agit à notre place dans les mythes.
X
Et puis, plus rien. Il y a bien l’écriture, les objets-textes, les chansons qui trottinent, les ressources des graphes, etc. Mais tout ceci n’est plus de la littérature et l’exercice ne tente pas forcément les générations futures soumises à leur fatalité de choses du passé. Si l’on veut bien imaginer que le temps présent n’est qu’une facilité de langage (nous n’en possédons pas l’instrument de mesure ni les moyens de calcul), que le passé est une possibilité imperfectible autrement que par des solutions imaginaires et le futur une autre possibilité sur quoi on peut espérer exercer une influence (question du désir posée à l’encan), alors on est capable de mesurer la fragilité de nos raisonnements, de nos intrigues, de nos peintures livresques et de notre peu de chance de trouver du nouveau, sombre désir de chrétien aux prises avec son sexe, pauvre sexe voué à la poussière des futures édifications de la cité ou au cuir muséal des momifications. Dans l’attente, nous proposons des imitations, des approches, des exercices, des impostures et des abstractions. Et nous n’avons aucun moyen d’y clairement discerner ce qui fera l’objet d’un culte et ce qui continuera d’alimenter le désir. Par contre, nous sommes parfaitement en mesure de distinguer, dans le fatras des illusions narratives, ce qui a quelque chance de nous approcher sensiblement des terrains favorables à des suppléments de durée et à des reconnaissances claires.
Ce qui équivaut à affirmer qu’aucune oeuvre romanesque n’a de chance d’atteindre un point considérable du futur si elle a, en son temps, fait un usage abusif du témoignage, de la mode, de l’intrigue et même d’une doctrine destinée à donner une leçon de comportement par son explication des données et par les ornements de son style. Il y a peu de chance en effet pour que les affres de l’inceste pédophile ou les conséquences traumatiques de l’abus d’alcool, par exemple, impressionnent à ce point nos descendants que le caquet leur en serait coupé et que du coup, les sujets prometteurs en seraient diminués d’autant, prenant par la main ce futur hypothétique pour le conduire dans les zones passives d’un silence définitif. Ils continueront au contraire de s’exprimer sur ces mêmes sujets sans même chercher à comparer leurs sensations avec celles qui occupent aujourd’hui les récits circonstanciés et le babil de nos victimes de la nature humaine en proie à ses combats d’insertion sociale et métaphysique. Après tout, que peuvent valoir ces textes quand on est finalement mieux renseignés par le moindre rapport de police ou la pire des sentences judiciaires, au fond par le professionnalisme et non pas par ces tentatives piteuses et mélodramatiques qui relèvent du spectacle et non pas de la lecture proprement dite ? Les émigrations historiques, les étouffements familiaux, les actes de funambulisme, les croisements intempestifs, s’ils nourrissent quelquefois l’aventure de leurs péripéties, n’en font pas ni l’histoire, ni l’éthnologie sociale, ni la psychologie du comportement ni la théorie des graphes. Chaque fois que la littérature se prend pour le lit des prophéties et des commandements de la vie, elle renseigne peut-être la passivité recherchée des utilisateurs du livre et de ses promesses d’éducation et de savoir, mais elle n’atteint pas cette fraîcheur constante qui promeut le texte dans toutes les langues et par tous les temps qu’il fait. Il y a destin et destin.
XI
Il y a le destin des constantes et celui des connaissances. Autant dire que les constantes de la nature humaine, si mal partagées que toutes les tentations de l’éthique se résument au combat fratricide du bien et du mal, sont connues depuis longtemps et qu’on n’a pas l’espoir d’y remédier autrement que par le resserrement périodique des conditions d’existence. L’Histoire pourrait bien être d’ailleurs celle des pressions et des relachements successifs que ses personnages et ses ombres supportent avec plus ou moins de patience. L’inertie de l’argent et du pouvoir tempère les durées de cette patience avec une habileté qui n’a rien de scientifique mais qui tient plutôt de la tactique législative et administrative, tactique des gouvernements ou pire des régimes. Il n’y a pas là matière à littérature ou en tout cas, cette matière qui colle forcément à la peau est un détail de l’ensemble, une écaille de bonheur ou de malchance, une présence accessoire des extases qui agissent sur notre durée comme la ponctuation sur le débit de la phrase ou de la boisson, au choix. Et il va sans dire que ce choix n’est pas celui de l’écrivain, romancier de surcroit.
Il en va autrement de la connaissance et de ses abouchements avec le terrain de l’action. Les relations à l’éthique et à l’esthétique sont clairenment provisoires. Les caresses à la langue, si chères aux patriotes, ressemblent à toutes les caresses prodiguées à la surface de la langue et dans ses replis prometteurs d’autres profondeurs comme l’étoile signale des possibilités de divination. On ne va jamais bien loin avec la langue, on ne va pas plus loin que son existence réelle, on finit par s’adresser à des conservateurs dont la mémoire est destinée à flancher un de ces jours, ne nous illusionnons pas sur la capacité de ces ouailles à retarder l’échéance de l’oubli au-delà du raisonnable. Par contre, ce qui est fait est fait et les résurgences le démontrent à intervalles non pas d’histoire, ni de régimes politiques, mais de littérature pure et simple. Et contrairement à ce qui arrive aux dieux promus à une existence monothéiste et dialectique, on n’en doute pas, on n’en remet pas en question ni la probabilité d’existence ni la pertinence spirituelle. La mythologie grecque, qui amuse encore les enfants pris aux pièges des jeux et de l’optique de la victoire, est une imbécillité de la pensée humaine, une scorie mentale à renouveler avec les moyens du bord, alors que l’Odyssée est un grand texte, même traduit et en dehors de sa langue-gangue (Gilgamesh). Il faudrait une destruction physique et une contrainte inouïe pour procéder à la disparition de ce texte. De plus, il précède toujours à la fois ses commentaires, ses adaptations et ses imitations.
XII
Alors, quel est le projet dont il est question ici ? On en revient au problème des solutions (ou à la solution des problèmes) et à la validité de ses deux principes : ------------- Il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des solutions ; ------------- Il n’y a pas de solutions parce qu’il n’y a pas de problèmes.
Il n’est plus question d’hésiter, plume en main, devant l’alternative du romantisme, et de ses corollaires le réalisme et le surréalisme - avec son personnage central doué d’une force centrifuge fragmentaire et fragmentant -, et l’immobilité croissante d’un symbolisme que les choses secrètent comme si elles étaient les glandes de l’organisme qui nous encercle. Entre les personnifications exemplaires et les sécrétions glandulaires, la différence de ton et de contenu est telle que la comparaison est un simple moyen de l’alternative et non plus une exigence de la raison. On penche d’un côté ou de l’autre, avec plus ou moins de bonheur et d’angoisse, mais on penche comme le platane de Valéry, c’est-à-dire comme une image et non pas comme un principe indiscutable.
Quant aux simultanéités et aux intermittences, ce sont elles, à coup sûr, qui conduisent encore de nos jours nos actions sur le roman et sur la langue. Un langage n’est jamais loin dans ces conditions de survie aux tentations académiques. Mais cet autre moi qui écrit en chassé a-t-il quelque chance de pallier la disparition inévitable des textes comme la biographie, vraie ou fausse, de Diogène de Sinope nous concerne encore aujourd’hui et sans doute définitivement en remplacement des oeuvres, désormais perdues, qui contribuèrent peut-être à sa renommée de philosophe-chien ? Les mythes se passent aisément de l’enrobage littéraire ; la lecture semble s’allier au plaisir pour finalement n’exister que par son exercice limite. Le texte du roman, tout empreint de sa beauté sonore plus que textuelle d’ailleurs, ne se croise plus par épanchement des désirs réciproques mais par rencontre préparée au fil d’une éducation qui ne doit pas toujours ses lettres de noblesse ni à la finesse d’esprit ni à l’à-propos des interventions mondaines. Et si les grandes reconstitutions livresque ne convainquent pas le lecteur peu outillé pour suivre le fil de l’oeil et des présupposées marées de l’inconscient, c’est parce que la patience elle aussi à ses limites, surtout que l’abondance d’objets provisoires finit par mettre fin à l’incessant recours aux dictionnaires d’époque et que la filmographie des lieux et des temps, que des personnages traversent en aveugles de leur bonheur et en principe de leur propre malheur, est au moins aussi parlante (mais on revient là au combat illusoire du démotique et de l’écrit) que l’écrit en proie aux techniques primitives du conte et de ses effets secondaires. Conter ou ne pas conter, telle est la question.
XIII
Or, le roman conte. C’est même peut-être tout ce qu’il sait faire. Le roman a longtemps été un arrangement de contes et, si l’on y regarde de plus près, il n’a pas changé d’un iota. Il s’est peut-être rempli de variations exemplaires c’est-à-dire qu’il n’a hésité, au fond, qu’entre sa fonction évidente de moyen d’évasion (fantasmagorie-santé) et ses possibles relations avec l’éducation (science-sociabilité). Le choix est donc celui du lecteur : faffer ou se mettre du plomb dans la tête. Quant au romancier, il se donne en spectacle comme un artiste de music-hall (prestidigitateur, danseuse nue, acrobate, chanteur) ou il préfère communiquer sa connaissance des lieux et du temps pour dresser des personnages sur leurs pieds et, sinon leur donner la parole, du moins en décrire la parabole ou l’arrêt. On est tout près de l’art de la performance à ceci près que le romancier-chien, muni de sa lampe en plein jour et sur la place publique fréquentée par le "plus grand nombre" (dénominateur commun), ne rencontre que des hommes et non pas leur absence ni la question de l’homme posée à des hommes appartenant à la même secte philosophique. Et il n’y a pas plus de misanthropie là dedans que de beurre en broche. Il n’y a que la vérité qu’on écrit pour ne pas la dénaturer en la disant. Mais ceci n’enlève pas au roman son caractère démotique, sa propulsion périodique aux antipodes de la littérature, avec des rétablissements lombaires aussi pharamineux que l’expérience célinienne de l’humanité en guerre. Le lecteur, imaginaire dans l’attente de l’écoute, est regardé comme l’acteur envisage les yeux du parterre et des balcons. Il n’en faut pas plus pour chercher à se mettre à sa place, comme si l’un pouvait remplacer l’autre, comme s’il n’était pas clairement établi une bonne fois pour toutes que les rôles ne sont pas interchangeables et que l’usage des doublures et des souffleurs n’impliquent pas l’existence caché d’un concert de lois autres que grammaticales et syntaxiques. Le conte tue le roman à un moment donné, seul temps qui l’occupe et non pas celui d’une mémoire qui s’ajoute au texte comme la mouche au miel.
Difficile de conter si l’on soupçonne, à l’instar du juge qui se mue en silence quand un rapport de gendarmerie comporte des traces évidentes d’incompétence ou de malversation. Le romancier n’est pas un homme de loi. Il n’est même pas juge. Il n’y a pas de tribunal dans son oeuvre. L’oeuvre est dans un tribunal et, bien sûr, on peut toujours rêver qu’on en est à la fois le législateur et l’inquisiteur (le réquisiteur). Tout ceci dans un esprit de géométrie qui confine à des démonstration d’écriture-parole dont la rigueur reste à démontrer. Tout ce qu’on savait déjà peut servir à quelque chose et ce qu’on peut en penser après tout n’est pas le meilleur moyen d’en venir au fait. En s’arrachant à son carcan démotique pour écrire, en renouant des liens d’auteur à personnage avec la parole donnée, en donnant la parole et l’écrit à des sensations apparemment en concordance avec l’époque, en contraignant le roman à se mordre la queue pour remplacer les effets soporifiques de l’intrigue, en coupant le lecteur de ses racines, en l’arrachant à son jardin des mythes et des frissons, trop de formalisme revient à expliquer au lieu de raconter. Explication par l’illustration à plat, par les figures d’un possible nouveau style qui appartiendrait à plusieurs pour former école. Ces délires éditoriaux seront bientôt regardés comme les preuves de la fragilité de l’esprit quand celui-ci domine l’autre par la simple imposition de sa capacité à raisonner, à équilibrer les facteurs et les membres de sa supposition jusqu’à l’apparence de la cohérence et pourquoi pas d’un nouveau modèle de la logique universelle. Une géométrie pour pallier des latences mystiques n’est pas la définition du désir. Elle ne concourt pas à la persistance du roman. Elle n’est qu’un accident de la pensée au travail de l’écriture. À ce train, on va finir par croire (textuellement) que le monde est constitué par un haut et un bas, comme en religion, ou par un dedans et un dehors, ou par je ne sais quel applatissement en diagramme d’un univers dont la complexité (l’imaginaire) est chaque jour mieux mise en évidence par des sectarismes autrement favorables aux véritables découvertes. Ah ! l’antinomie kantienne !
XIV
Enfin, est-ce cohérent de ne retenir que la langue du langage pour effectivement écrire un roman ? Est-ce même raisonnable de limiter l’oeuvre au roman ? N’est-ce pas ainsi croire un peu vite à l’existence des genres comme les petits dieux de l’espace littéraire ? Ne procède-t-on pas plutôt par multiplication cellulaire comme au sein de la chair et des chimies de la chair ? N’en revient-on pas finalement à se satisfaire ou à satisfaire - ce qui est quelquefois la même chose - (de) ce que le roman offre de diversité et de chance de plaire au plus petit dénominateur commun ? - Questions que je me pose et auxquelles je répondrais directement si je ne pouvais être que l’investigateur de ma propre existence textuelle et peut-être littéraire (sait-on ?). Mais je n’y réponds que par l’existence et par la croissance évidente de mon ombre portée à la surface des choses dont nous héritons tous même si nous ne les possédons pas toutes et si, le plus souvent, nous n’en possédons que les moins faciles à mettre dans le jeu des autres. Malgré les aléas de la vie, malgré le peu de fortune et les emmerdements croissants, j’ai appris à me servir des outils du langage : musique face au bruit, représentation graphique en deux ou trois dimensions face à l’approximation des points de fuite sur l’horizon, mais ne sais-je pas aussi sourciller dans les circonstances du sourcil, baver un peu aux commissures dans celles de la concupiscence, trainer sur les syllabes si la conversation exige une ornementation, être le comédien de mes grignotements de temps pour me donner des apparences, etc., somme toute que ne sait-on pas faire peu ou prou pour résister à la tentation du sommeil ou de l’extase chimique ? Ceci pour dire que le fatras sentimental et intellectuel est le même pour tous, l’écrivain, poète soit-il, n’y coupe pas lui non plus. Un choix devrait n’engager à rien mais pourquoi ne pas reconnaître qu’il n’y a aucune raison pour qu’il demeure sans conséquences sur la question posée ? Je ne saurais jamais pourquoi c’est le roman qui prend le pas sur le chant ou la réflexion littérale. Il (le roman) s’immisce partout où je prétends donner de la voix ou du texte - ne soyons pas chien au moment de donner et donnons sans y revenir. Je n’ai donc pas d’explication. C’est peut-être un coup sérieux porté à ma nature hypothétique de poète du roman auteur du roman du poète (et de son entourage). Mais qu’y faire ? Continuer d’écrire en espérant trouver un jour la force nécessaire aux resserrements du style et de l’expression ou me planter tout seul dans les poubelles minérales de mon jardin et questionner mes arracheurs de fibres ? Tel est le destin de la pensée qui installe les conditions de l’alternative : il arrive un moment, et on vérifie par l’expérience que c’est bien un moment et non pas un fragment de l’espace qui se concrétise, où la suite à donner dépend d’un choix arbitraire que le plus souvent on abandonne aux sensations de surface avec le sentiment qu’elles sont capables de donner une certaine profondeur à ce qu’on désire plus que tout exprimer, voire écrire, se soumettant une fois de plus aux mises à plat de la philosophie. Les diagrammes n’ont jamais sauvé l’esprit de la dérive mais ils ramènent à l’éducation, à la formation, à ces petits agenouillements, ces prosternations infimes, ces mortifications sommaires dont nous nous nourrissons plus facilement que de nourritures terrestres. Mettons.
XV
C’est en boitillant un peu que je vais essayer d’achever cette réflexion, en commençant par la question de l’oeuvre totale qui vient donc d’être posée supra, avec cette petite différence qui doit avoir son importance, que le roman du XIXe siècle n’eut pas à subir les assauts des prétentions à l’oeuvre totale alors que le roman contemporain est aux prises avec les oeuvres multimedias qui viennent tout juste d’améliorer les conditions d’existence et de profit de ce qui s’annonçait en son temps comme le futur des supports : l’audio-visuel, une espèce de cinoche mais en plus resserré, moins amusant aussi mais nécessaire et finalement obligatoire. Il y a de fortes chances pour que, dans un avenir désormais proche et certain, construit de proximités et de certitudes - définition exacte de la foi qui abrutit nos semblables -, le roman ne devienne, avec les autres genres, le laboratoire du multimedia, après en avoir été le fournisseur pointilleux. Déjà soumis à des comparaisons cruelles avec le simple scénario, il ne lui reste plus qu’à lorgner du côté de ses adaptations possibles, au mieux, et de ses participations secondaires au pire, pour tenter d’échapper à ce destin morose en inventant les procédés de son échappement. C’est-à-dire qu’il a maintenant besoin ou de disparaître en tant que tel, ne proposant plus désormais que son passé glorieux, ou bien de s’inventer cette fois totalement, comme s’il n’existait plus ou comme s’il n’existait pas encore, comme s’il était sur le point de tenir ses promesses. La lutte, puisqu’il s’agit de survivre, est inégale. On ne se bat pas avec la passivité de son adversaire. On aurait pu se battre avec la nature du multimedia mais il n’y a aucune chance de gagner du terrain dans les conditions de passivité que le multimedia exige de soi et surtout des autres. Le temps n’est pas loin où il suffira de pénétrer, en vrai ou virtuellement, dans les lieux et le temps de ces distributeurs de l’art pour gagner en humanités ce qu’on a peut-être perdu en maturité à l’école même. La prostitution a ses adeptes et le vol ses défenseurs, et les nations une politique cultuelle.
XVI
Parvenu à ce point tangible de ma réflexion sur le roman, il ne me reste plus qu’à en résumer les prémisses majeures et à en tirer les conséquences ou plutôt à revenir à la publication du RENDEZ-VOUS DES FÉES pour peut-être en justifier l’immaturité et pourquoi pas l’étrangeté. Il m’a donc semblé que le romancier qui aujourd’hui prétend dépasser ne serait-ce que d’un iota les productions romanesques de notre temps devrait se poser la question de savoir sur quoi il finit toujours par asseoir les excroissances de son art. Éliminant une bonne fois pour toutes les [auto]biographies du romantisme et les désincarnations du symbolisme, au fond les retours à soi, les dématérialisations fugaces, les opiniâtretés des surfaces, les profondeurs exutoires, les prières d’insérer, les possessions, les rêves, les cris, les automatismes, les nouvelles figures de style ou se donnant comme telles, les rencontres nettement extérieures, les enclouures des mots, les existences transparentes et je ne sais encore (pour les avoir pratiquées et en trouver encore la trace nerveuse dans mes écrits) quelles contingences favorables plus aux variations du savoir qu’à l’invention véritable, - éliminant la litière pour se poser lourdement sur la terre battue, il n’y a plus guère que deux voix à éclairer pour suivre les chemins à la fois fragiles et dotés de pouvoirs de conviction que le roman continue de tracer en nous comme une maladie de l’esprit au travail de la réalité.
La réalité est une proie pour l’homme. Ses simultanéités, bulles des voix qui sourdent d’une complexité due à l’épanchement croissant des existences dans les milieux les plus divers, ne sont que le moyen d’accéder au tourbillon de la vie. On sort de soi mais à partir de soi et non plus dans l’ombre propre des objets du symbolisme. Le vertige est propice plus au plaisir par étouffement, accompagné ou non d’autres pratiques du ravissement qui laissent présager, par leur prépondérance, un bel avenir aux usages multimedias de l’attente, qu’à ce halètement qu’on attend peut-être des soins apportés aux détails. Se perdre pour se perdre, même à la faveur d’un frisson véritable, c’est remplacer l’arbitraire des fluctuations modernes sur le roman par l’imposture d’une vision projetée à grands cris sur les murs environnants notre détresse.
Par contre, les intermittences me paraissent, soit parce qu’elles créent un autre type de personnage franchement nouveau et surtout différent de tout ce qui a peuplé le roman depuis ses origines connues, soit parce qu’elles facilitent vraisemblablement le passage de la perception à l’écrit, plus définitives comme moyen, plus transmissibles de génération en génération, solutions imaginaires, complexes donc, mais la question reste toujours de savoir si, à l’instar des carrés d’un nombre négatif, elles sont vraiment capables d’extraire de la réalité et non pas de la jouer sans ce minimum de maturité qu’on est en droit d’exiger du romancier au travail de notre mémoire. La littérature est une métaphysique et non pas une science, encore que sans ses intuitions, la pertinence de l’expérience scientifique relève aussi de la perception et non pas de l’abstraction de quintessence. Mais si la littérature est le laboratoire de la langue, alors à quoi peuvent bien servir ces autres moi qui écrivent peut-être à notre place au lieu de nous laisser la place et le temps d’écrire ?
Ou alors la littérature n’est pas une métaphysique, on sait bien que ce n’est pas une science, et c’est tout simplement de l’art. Dans ce cas, nous n’avons nul besoin ni de méthode, ni de certitudes, mais de techniques mille fois soumises au feu de l’action qui consiste à écrire au lieu de ne pas écrire. Évidemment, ce serait là à la fois limiter les enjeux possibles et raccourcir impunément le chemin qui conduit à la première page des romans. Le mieux n’est-il pas, au fond, de ne jamais questionner l’esprit et de s’en remettre à la chair ou à ce qui en fait figure ? Dans ce cas, ne prend-on pas le risque d’épuiser, peut-être pas le sujet, mais sa continuité narrative ? Glisser de la littérature au spectacle, c’est se soumettre à des impositions simplificatrices tout simplement parce que le temps de lire n’est pas le même que celui dont fait usage le spectateur, encore que le multimedia, ses enregistrements, ses tables de contenu, ses procédés de mémorisation, semblent donner au spectacle un temps peut-être compatible, à défaut de lui ressembler, au temps des écrivains.
XVII
Quelle que soit la primauté accordée à telle ou telle prémice pour des raisons bien difficiles à éclairer quand la lanterne du lecteur perspicace s’en approche de près (on se sent plus romantique qu’autre chose par exemple, ou moins enclin à se satisfaire des coulures du réel sur la vitre du rêve, autre exemple), il n’en reste pas moins, et on semble ici revenir à de philosophiques procrastinations, que les romans durables sont soit des allégories définitives soit des analyses réussies. Les décorums s’étiolent toujours plus vite qu’on avait espéré, les objets suivent leurs usages dans la tombe où ne les retrouvent que des archéoloques minutieux, le caractère philosophique des oeuvres littéraires n’apparaît plus aussi clairement qu’au moment de leur mode, les concepts ne s’appliquent plus à la réalité avec autant de pertinence qu’à l’époque où on avait éprouvé la résistance de leurs objets, il est rare qu’un texte ne finisse pas sa vie sommaire dans les conservatoires obscurs où les langues s’amoncellent elles aussi. Ces peuplades souterraines ne servent même plus d’exemples, on les consulte pour d’autres raisons que la curiosité littéraire, elles rejoignent la chair mais ne pourrissent pas, elles ont une durée minérale. Ce sont les momies de notre mémoire. Mais il faut un couronnement à mon attente.
XVIII Le roman est donc une hypothèse, à ceci près que l’expérience qu’il est aussi est trop encline à l’intuition, au goût, à des hésitations éthiques, pour avoir quelque valeur incontestable. Il ne fait jamais l’unanimité et, n’était l’opiniâtreté des institutions, il y a belle lurette que les meilleurs textes auraient fini aux oubliettes. Quelles catastrophes, naturelles sans doute, nous ont déjà privés de trésors qui doivent bien nous manquer, à moins que la persistance de l’esprit ne les aient déjà remplacés ? Le roman a au moins cet avantage de nous placer physiquement au bord du néant où se trouvent d’autres réalités. Il pêche. Des petits poissons et des gros, tout dépend de l’appétit et de la chance, du temps aussi, celui qui reste à vivre, tant est délicate la question du temps qu’il faut pour se pointer à l’heure précise où commence l’oeuvre et où s’achèvent les apprentissages. Cueillir un écrivain vivant n’est pas aussi facile qu’on croit. L’arracher un moment à sa branche, à sa terre, à son lit et à ses tables innombrables, peut toutefois nous renseigner sur l’état de sa connaissance. Il n’est jamais question de lui mais de ce qu’on sait de lui, c’est-à-dire de ce qui est lisible, à la limite intelligible. Sa question nous interroge nous aussi ou pas. Réduit à la pâture, il a quelque chance de trouver des semblables, des frères. Ce n’est pas qu’il jette l’encre par les fenêtres, mais il attend tellement, si profondément, que sa solitude est le paravent de ses réponses. Il a choisi, ce qui ne nous est pas arrivé et ne nous arrivera jamais si nous n’avons pas appris à écrire.
Encore que cette hypothèse du néant laisse à désirer par son côté analogique. C’est Tytire. Mais je préfère Sade, sa philosophie antiphilosophique. Le néant, c’est ce qui reste de la nature quand on l’a comprise dans un système de phénomènes, d’actes, de personnalités, d’intentions, de désirs, de puissances, de tout ce qui alimente le propos incessant des philosophes. Les philosophies sont surmontées d’un seul mot qui, sans les résumer, les caractérise. Il arrive aux philosophies ce qui arrive aux romans : on n’en conserve par devers soi que le principe fondateur ou l’anecdote réductrice. Le mot "néant" ne surmonte jamais ces piliers de la sagesse et de l’exemple. On le rencontre en dessous, porteur de sens si différents et d’implications si diverses qu’on peut légitimement se demander si ce n’est pas avec lui que commence l’imaginaire et que s’achève la vie tranquille de l’imagination. Il est, dès les premiers signes de continuité des commencements, le reliquat de la chose physique mais il n’en est pas la relation à l’infime quantité qui dénonce les erreurs de calculs et les approximations instrumentales (voir ma <a href="http://www.lechasseurabstrait.com/revue/spip.php?article137">Lettre à Alain Robbe-Grillet). Pour qu’il existe, il faut le créer mais à l’instar de la division par zéro, qui n’est pas un produit imaginaire mais une intuition remarquable, il ne sert à rien de le créer si on n’a pas une idée derrière la tête, une idée de l’homme et de son exploitation systématique en vue d’en tirer un profit personnel ou à partager uniquement avec les membres de la secte ou de la tribu.
On se pose quelquefois la question de savoir comment on en est arrivé là, à ce point qui n’est pas une rencontre, détail significatif de ce doux métier qu’est la vie quand on la prend du bon côté et un enfer si c’est le mauvais côté qui se donne à réfléchir. Une intuition douloureuse, un doute pour tout dire, nous pousse à penser que le néant est une question de temps et non pas de situation dans l’espace. - N’est-ce pas cet oubli qui gît dans les ressources de l’unité, sa facilité à dériver de l’infini et à donner la mesure de toute chose ? La probabilité de se retrouver au présent à tout moment de cette éternité est réduite à zéro. Nous avons existé et pourtant, nous n’existions pas, pas que nous sachions et puis nous nous sommes mis à exister de moins en moins, fauchés une fois par la mort et réduit au silence et à l’absence faute de témoins de cette existence, eux aussi emportés par le même tourment. Mais le néantn’est pascemanqued’explicationssatisfaisantespuisqu’elles réussissent encore à le remplir d’anonymes ressemblances. Ce n’est pas non plus ce qui arriverait si Dieu n’existait pas. Le néant ne se nourrit pas plus de menaces que d’approximations telluriques. Il aurait quelque chance d’exister (métaphysiquement) si nous appliquions tout notre effort de recherche à ce qui n’a aucune chance d’exister une fois de plus. Le néant n’admet pas cet absurde. Il n’en soutient même pas l’hypothèse. Il n’est donc pas ce que je ne suis plus s’il n’est pas. Le néant est au mieux un instant de la pensée : "Il m’a effleuré l’esprit". Comme il ne sert à rien, on s’en sert dans les cérémonies et si le roman en est une, alors il apparaît dans les pires moments pour donner à penser au lieu de signifier quelque chose qui ait quelque relation avec les objets environnants le romanesque. Le néant, c’est de l’instant. Insaisissable, il peut prendre toute la place : d’où la nécessité d’un être dont il n’est pas la composante primitive.
XIX
On peut résoudre un nombre considérable de problèmes en se mettant subitement à croire en Dieu et même pousser le bouchon jusqu’à adhérer aux dogmes d’une religion. Débarrassé des questions sans réponses, il ne reste plus alors qu’à se concentrer sur son travail qui consiste quelquefois à écrire des romans. Ici, Dieu existant, le néant serait un espace compris entre la pratique des cérémonies et la probabilité de finir bien. Le temps, non content de le ramener à de plus justes proportions, on le renouvelle autant de fois que c’est nécessaire et on établit des échelles de proportions dont les sommets nous étourdissent de festivités traditionnelles. Dès lors, on peut tout imaginer, du moins en théorie, et construire des textes romanesques sans se limiter à la question du texte romanesque. Une pareille liberté est contrecarrée par des exigences de comportement d’abord prophétisées puis stigmatisées. Rien ne vaut une bonne marque de reconnaissance. On se demande même pourquoi continuer d’écrire des romans puisque le roman est unique (Passion de J.C., biographie de Mohammad, et autres Bouddha de l’hallucination collective et de la constance des recherches mystiques). Écrire des romans devient un art, clairement. Un art de convaincre, essentiellement, que Dieu est tout et le néant un endroit détestable. Mais pour pallier la tentation du suicide, celui-ci étant perçu comme la liberté de choisir d’être ou de ne pas être, prérogative divine sinon les peuples se suicident en masse sans attendre les génocides de l’Histoire, c’est l’enfer qui menace et le néant est plutôt ce que seul Dieu est capable de transformer en chose existante. Expliquant l’existence par le néant, les religions restructurent le temps en avenir prometteur, exactement ce qu’il s’agit de faire par exemple quand on écrit un roman policier. Imitation grandiloquente de ce pouvoir de créer que l’être humain possède à un haut degré de "civilisation". Dieu, c’est l’empêcheur imaginaire d’imaginer. Peut-on, dans nos civilisations religieuses, écrire librement des romans sans cette mutilation inacceptable ? Pas si sûr.
Si le sexe ne pose plus vraiment de problème, c’est qu’il a toujours fait l’objet d’un commerce. Les sociétés modernes s’attachent d’ailleurs assez sérieusement à légiférer encore sur la question pour limiter les débordements notamment sur l’enfance et les faibles. Le sexe, contre toute attente, n’a pas remplacé la religion ni interdit les regards obliques sur la nature. Les cultes s’imposent de plus en plus aux pratiques de l’existence. Réduits à la passivité de l’observateur mais pas au silence, comme tout un chacun, ils tentent de s’élever dans la hiérarchie du pouvoir, en commençant par exiger d’être informés directement et même consultés avant toute divulgation de la décision. Certes, ils ne décident de rien mais le simple fait de la consultation, comme si de sages il s’agissait, laisse augurer un bel avenir à ces excroissances du pouvoir. Va pour le sexe, dans certaines limites qui restent toujours à reconsidérer mais en va-t-il de même pour les objets du récit et les aléas du dialogue dès lors que ceux-ci agissent directement sur la complexité des questions existentielles ? Un Dieu philosophique est une attente, entre l’hypothèse et la certitude, mais le Dieu des religions est le signe d’une impatience rudimentaire et dangereuse. Personnage pour les uns, entité pour les autres, toute approche textuelle de la déraison en impose la stature historique et universelle. Heureusement, on nous en promet de belles question reproduction de l’espèce et pourquoi pas extase. Le roman doit en tenir compte et participer à l’équarrissage de Dieu comme au positionnement des tentations du vide.
XX
Ces considérations pourraient paraître inutiles en cas de prétentions artistiques mais en écrivant des romans, si je ne moralise jamais, je ne donne rien non plus à caresser. Et peu m’importe si on se pâme quand même dans les passages les moins périlleux (pour moi) de mon écriture et de mes inventions dramatiques. Il me semble important de prévenir le lecteur : ni le néant ni Dieu n’agissent librement dans mes aventures avec l’aventure des personnages. J’en critique ouvertement le contenu dans l’espoir que le lecteur, désormais informé, en gros, que je ne crois pas en Dieu, que pour moi les religions relèvent de l’ignominie comme la guerre et le viol, que les approches scientifiques me paraissent, malgré les approximations du calcul, pertinentes alors que les considérations métaphysiques et rhétoriques ne servent que de lit à mon étude de la folie et de la déraison, - que le lecteur apprécie à leur juste valeur ces autres dilemmes organisé en dilemme que j’appelle, à tort ou à raison mais faute de temps pour en vérifier l’à-propos, un roman. Il y sera question, comme on va le lire, de destin et d’instant.
XXI
À la mesure de l’homme, de ce qu’il est instantanément et de ce qu’il devient pour peu de temps, c’est l’arpentage qui prévaut contre la géométrie. Personnellement, je n’ai jamais vu ni connu l’espace et ma notion du temps s’apparente plutôt à la vue courte et aux hâtes désespérées du quidam. Mes personnages témoignent de cette mise à niveau. Notre vision du monde est arrêtée par les vitrines de nos usages et les portillons de nos attentes. Les personnages suivent les mêmes fils sans risquer de ne plus ressembler à rien. On a beau se creuser, comme pratiquants de l’apnée, il faut une certaine dose de croyance ou de jeu (mais qu’est-ce qui inspire le jeu plutôt que la croyance ?) pour se plonger dans la réflexion jusqu’à une certaine obscurité qui témoigne à la fois de la complexité de la situation et du peu d’importance que peuvent avoir sur nous les raisonnements appartenant au passé de notre propre raisonnement, ce que nous prenons pour des racines, exactement comme s’il était clair que nous sommes cultivés et produits de la culture et que l’obscurité est une affaire de temps.
Les cordes à noeuds des théories, modèles et autres règles de trois, traversées de ce que le mathématicien moderne préfère appeler des complexes plutôt que de retenir le mot qui vint d’abord à l’esprit de leurs inventeurs : des imaginaires (par rapport aux réels bien sûr), ne tiennent pas longtemps à l’usage. Mais un point commun remarquable de ces outils de l’arpenteur consiste en leur part de réussite, donc de vérité et de soulagement au moins partiels (allez donc savoir ce que cela peut bien vouloir dire) et il se trouve que des outils (thérapeutiques par exemple mais aussi politiques, publicitaires, éducatifs) fonctionnent assez bien, permettant l’exhibition spectaculaire des résultats pour aussitôt à la fois entrer dans la légende et devenir sujet à caution. On ne joue plus, on se met à croire, avec ou sans Dieu, croire c’est résister au néant, à sa tentation facile. S’il s’agit de donner un sens au désir, c’est-à-dire des réalités, on ne joue pas plus loin que l’enfance ni plus vite que l’âge. La mesure de l’homme ne permet pas de jouer sans un suicide au bout du jeu. L’homme croit ou n’est plus.
Dans ces sinistres conditions, l’entreprise d’un roman est une épreuve de force. Le texte, pas plus explicable qu’un caillou ou un brin d’herbe, mais pas plus prometteur de découvertes, fait florès quand le jeu semble en valoir la chandelle et là, les époques divergent tellement (en fonction me dit-on de l’état des connaissances et par conséquent de la capacité d’affronter les tenants de la conservation sans risquer d’embraser en soi les bûchers des places publiques) que la simple compréhension d’un mot ou d’une attitude finit par relever du casse-tête et de la bonne volonté. Écrire, c’est construire en dehors du temps mais lire est une activité temporaire. Ces passages de l’autre à la surface de ce qui est une profondeur déterminent la durée du texte sans jamais tenir compte du moi qui l’écrivit ou est en train de l’écrire. L’autre, en bon voisin, et selon des règles de proximité prévues par l’usage, finit par écrire ce qui n’est peut-être pas écrit et le moi devient une biographie à ajouter à l’oeuvre comme c’est l’usage en religion où les biographies et les commentaires se donnent des allures de pratiques scientifiques, rêve caressé des philosophes qui verraient bien la métaphysique comme science, au moins petit à petit, par grignotement expérimental.
XXII
Le corpus de la critique fait office, ce n’est pas peu dire, de littérature par l’exemple. Ainsi, le roman de l’humanité prendrait ses formes aux jeux de l’individu doué pour l’expression romanesque ; il serait à prendre en considération au moment d’écrire ce qui nous passe par la tête quand il pourrait plutôt ne plus rien se passer. Par suite, il ne s’agirait pas de donner aux mots tous les sens qu’ils peuvent contenir sans perdre le sens, mais de donner un sens à nos compositions via les pratiques de la langue mise à la place du langage pour faire bonne figure. Des vocations naissent parce qu’on les a semées. L’homme n’est pas à ce point opiniâtre (encore une idée jetée par impression d’avoir raison) qu’il est capable de génie. Sournoisement, Cortázar explique que le génie, c’est parier qu’on est génial, et gagner son pari. Ceci serait une simple boutade si Cortázar n’avait pas consacré dix ans de sa vie à reconstruire le roman à la mesure de l’homme et obtenu un résultat difficilement contestable avec des arguments d’écrivain. Heureusement, le marché de la littérature générale permet de distinguer les oeuvres importantes de celles qui rapportent à leurs auteurs les lauriers provisoires de la reconnaissance du ventre. Certes, la différence ne saute pas toujours aux yeux de tout le monde pour le plus grand bien des résultats d’exploitation et, cela va sans dire, toutes les oeuvres de qualité ne sont pas invitées au festin de l’immédiat et de la perspective des vacances. Le concert se limite pour demeurer musical sinon les chaises se vident dans un incessant raclement du parterre et les repliements des strapontins doués de souffle court mais intempestif. À la question du roman de l’humanité en cours (selon Sartre), s’ajouterait celle du génie à mettre en jeu sous peine ne n’être pas jugé. Un écrivain aussi secret et modeste que Paul Gadenne, malgré sa ténacité d’homme et d’écrivain, restera malconnu jusqu’à ce que la voix de ses admirateurs se fasse entendre. Gare au suicide par inadvertance (négligence dans le style).
Là (ou à l’heure) où les philosophes proposent inlassablement des expériences inacceptables dans les conditions de laboratoire qu’on exige des scientifiques (dont la plupart ne sont d’ailleurs que des ingénieurs, une chose expliquant l’autre), le romancier (pas plus que l’ingénieur) n’est en mesure d’apporter ne serait-ce qu’une goutte au moulin philosophique réduit à la peau de chagrin métaphysique. L’échantillonnage philosophique, capricieux ou fugace (propriété ajoutée ou intrinsèque, voire), est moins docile (ou facile, même jeu) que les jus utilisés dans la recherche scientifique (et technologique, autre jeu). Le travail de l’écrivain est mis sur le même plan que celui des bavards que nous sommes dans la vie de tous les jours. L’homme, c’est l’homme, un point c’est tout. Comme si c’était de la rigueur, cette affirmation. Or l’homme, aussi bien ce n’est pas l’homme et l’écrivain moins que les autres. Dès l’entrée en matière, on est sollicité par de pareilles démonstrations de perspicacité. Du coup, le jeu des philosophes apparaît de moins en moins scientifique, donc de moins en moins utile, de plus en plus agaçant. Comme il n’existe pas une communauté des écrivains, c’est l’écrivain en personne qui fait entrer l’écrivain (lui-même en principe, c’est plus facile, moins cher) dans ce qui n’a rien à voir avec un laboratoire, à tel point qu’on est déjà censé y perdre son temps. Pourtant, c’est à ce prix, nous le savons bien, au prix d’une perte de temps incalculable et donc incompatible avec l’économie de moyens qu’exige la production de biens comptables, que la littérature devient une littérature et non pas un document d’époque sur les gens de l’époque en question. Qui, d’ailleurs, se posera des questions sur toutes les époques avec la même attention de chercheur pointilleux ?
Un roman de l’humanité (désir) ; le pari du génie (puissance), pari à lancer soi-même sans attendre l’approbation de la tribu ; et l’athanor (plutôt que le laboratoire) des oeuvres, - il n’en faut sans doute pas plus à l’homme générique pour inspirer à l’homme écrivant des particularités littéraires. Tout ceci est bien discutable et mériterait un approfondissement par le partage et la mise en commun. Mais ne suffit-il pas de brosser le tableau avec un minimum de couleur plutôt que d’essayer toute la gamme chimique où les réactions au gris et au pituite menacent de s’enchaîner les unes aux autres pour finalement ne rien décrire ? Le croquis est une attente et une fin à la fois, qu’est-ce qu’on y peut ? En tout cas, le lit est fait pour continuer cette petite réflexion sur les grandes perspectives du roman qui, n’en déplaise aux marchands de sommeil, ne meurt pas dans l’obscurité pas plus que les morts ne renaissent dans la lumière. Le commerce, qui est en effet une forme légale de voler son prochain mais dont les États, puissantes sectes, ne peuvent pas se passer pour alimenter leurs luttes intestines et parallèles, ne crée pas la littérature qui le vomit tous les jours parce qu’elle s’en nourrit elle aussi. Revenons à la mesure du roman.
XXIII
Les instances du roman commnunément admises sont : le personnage, le temps, le lieu et l’écriture (voir VIII). Cette approche structurelle peut réduire n’importe quel roman à un discours sur le roman. Très pratique en cas d’enseignement et même de recherche, elle ne vaut plus grand chose au moment d’écrire mais un écrivain peut raisonnablement évaluer son oeuvre en constatant les valeurs ajoutées à chacune de ces variables. Un simple regard sur ce repère indispensable lui permet de constater les manques, d’équilibre par exemple ou de pertinence. Il peut aussi doser les importances accordées, pour des raisons doctrinales ou autres, à ces paramètres de la constance romanesque. Il est toujours agréable de disposer d’un outil capable à la fois d’évaluer ce qu’on cherche en effet à mesurer et efficace une fois les corrections apportées, c’est-à-dire tout aussi capable de vérifier le poids des changements sur l’ensemble. De plus, c’est en manipulant savamment ces données que le romancier donne une formulation aisée (et publicitaire) de sa théorie du roman. L’accent sera le plus souvent mis sur une de ces instances, rarement sur plusieurs. Les variations, tout aussi à l’origine des doctrines, caractériseront des pratiques indubitablement différentielles. Ce paramètrage musical, avec sa verticalité (personnage, lieu) et son horizontalité (temps, écriture), se donne, sinon pour une science, du moins pour un art du roman, de la partition du roman comme lit du roman. On conçoit mal d’écrire des romans dans d’autres conditions préalables ou alors ce ne sont pas des romans, déclare-t-on s’ils sont écrits et une fois seulement qu’ils sont écrits. Cette manie de superposer les transparences des arts pour en constater les coïncidences est équivalente à la persistance rétinienne et, en entretenant la circulation linéaire des oeuvres, dans une anthologie par exemple, le film se déroule sur l’écran de nos perceptions comme si la réalité s’y trouvait éclairée.
Il n’est pas facile de se soustraire à ce jeu du miroir aux alouettes tournoyant à portée de fusil. Et les règles ne sont pas clairement établies. On sent bien toutefois que la sensibilité acquise à force de présence parmi les siens n’est pas universelle et la perception d’autres systèmes d’approche paraît du coup tellement différente, tellement porteuse de dénonciations et de nouveautés, que l’engagement devient nécessaire et la défense organisée sur la base d’un mélange savant de communication courtoise et de moyens de destruction. (L’"art moderne" n’est rien d’autre qu’un emprunt au Japon et à l’Afrique doublé d’une remise en question purement théorique de l’art.) Le combat engagé contre la contreculture se poursuit à l’extérieur avec la même audace. On peut légitimement se demander si les instances bien pratiques dont je parlais plus haut ne servent pas plus la lutte entreprise contre la différence que le roman lui-même quelquefois si essentiel dans la question de la survie personnelle. Tout se passe en circuit fermé, rien ne se réduit à la personne, comme si le cercle n’avait pas de centre mais que sa géométrie demeurait toutefois parfaitement acceptable. Ne pas se poser ces questions à l’intérieur d’un roman relève de l’aveuglement, de la soumission et de la nette intention de remplacer la perspective du bonheur par autre chose. Quant l’appétit va, tout va, semblent nous dire ces romanciers méthodiques dont les négligences de style font partie de l’attirail des apparences destinées à remplacer les prémices du bonheur. Ajoutons qu’emprunter à l’extérieur du cercle tracé ne revient qu’à introduire les éléments d’une autre façon de soumettre la pensée aux nécessités vitales. Les relativités, au lieu d’inspirer la pensée, aggravent sa tendance à revenir sur les lieux de sa naissance. Sans parler des pèlerinages mis en place justement dans la perspective d’universaliser les principes y compris au sein des universités conçues par les États, les religions ou les intérêts privés (du pareil au même, malgré les petits détails de principes). Le tournoiement ne peut aboutir qu’à l’immobilité ou au consentement.
Si donc on enfreint les lois, il faut prévoir d’entrer dans un système de jugement des valeurs ni contradictoire ni égalitaire. Ce qui n’équivaut pas à une renonciation. Et puis ne pas confondre la plaidoirie adressée à son propre monde, qui contient la critique et ses faillites, et la réduction aux principes, qui est le passage du constat (un tableau) à sa représentation graphique.
XXIV
I-1 - Repère pour représenter le roman et ses variations possibles.
I-2 - Schéma pour donner une idée de ce qui est ici autrement conçu.
I-3 - Tentative de mise à plat de la transformation obtenue.
Cette mise à plat ne remplace pas le roman lui-même (Aliène du temps et ses (a)tomes). Ce n’est qu’un croquis commode de ce qui arrive au roman quand, à la suite d’une hallucination ou d’une vision plus tranquille, on applique la transformation à un état du roman qui lui ne se prive pas de schématiser pour mieux pratiquer ses perforations filetées. Quand je peins, je commence par décider de la méthode que je vais employer, en fonction du liant, de l’agglutinant (gomme, huile, résine), de l’importance accordée (peut-être théoriquement) aux contrastes de couleur et de matière, je commence par le foncé ou par le clair, je sais si ça sèche ou si ça se polymérise, je dispose de deux ou trois couches, c’est à voir, j’utilise la transparence, l’opacité, la brillance, la matité, je commence par une grisaille, par des empâtements, par doucement teinter le blanc d’un jus ou gravement tracer les ombres ou les contours, jamais je ne me lance dans cette aventure sans en mesurer la physique et le temps d’attente nécessaire par exemple entre les couches. Idem pour la composition musicale, notant au passage que la musique est le seul art où l’idée de composition fait partie de la désignation. Tout art, par sa mise en pratique, réclame un atelier. Mais au lieu de préciser si avant d’écrire je me vide ou pas de mes excréments, anecdote facile proposée par Duras pour éviter de parler du fond de la question avec un interlocuteur qui ne l’aurait alors pas comprise (alors que le détail physiologique le réclamait), je choisis délibérément de m’expliquer en toute modestie, prenant le risque de n’être plus tout à fait dans mon élément et de paraître tenter de combler des vides avec autre chose qu’une matière romanesque non trouvée en écrivant. Il n’est pas interdit d’appliquer la méthode traditionnelle, ou une de ses variantes, au texte qui prétend échapper à son contrôle. Le résultat conclura immanquablement à l’obscurité, à des défaillances logiques, à un tournoiement insupportable, regrettant qu’un écrivain aussi doué pour l’écriture (j’en suis conscient) perde son temps (et celui des autres) à écrire des choses qui refusent d’entrer dans le carcan. Je propose donc une autre méthode d’évaluation. Il va sans dire que cette méthode, qui est le commentaire du roman en soi, n’entretient peut-être aucune relation avec le roman en question (celui que j’écris) et que la parodie n’est pas loin. Cependant, un simple exercice démontrera vite la pertinence du propos. Notons que je ne me révolte pas et que je n’applique pas cette méthode à des romans qui n’ont pas été conçus pour l’éclairer. Jeux compliqués de tous les théâtres du plaisir dont un homme ou une femme peut être l’apparence surprise sur le fait. |
|||
|
|
|
Revue d'Art et de Littérature, Musique - Espaces d'auteurs | [Contact e-mail] |