|
|
Revue d'Art et de Littérature, Musique - Espaces d'auteurs | [Forum] | [Contact e-mail] |
|
||||||
4 - Le personnage incréé
|
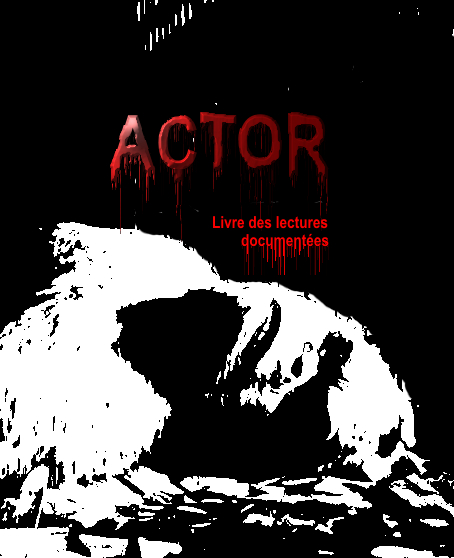
|
|||||
|
| Navigation | ||
 oOo Demeure mon cadavre, tournoyant disait Barrès à propos du sien, s’immobilise le thème des thèmes et dure la lecture en dehors de toute considération littéraire [...] Demeure, immobilité, durée. Si je l’écrivais, cette thématique, elle porterait là-dessus.
Questions
Ensemble, nous ne sommes jamais complexes, sinon différents. Que ces différences, aussi sensées, aussi précisément exprimables sont-elles, puissent donner lieu à des lois de composition utiles et même nécessaires, cela ne revient pas à soi aussi facilement ; en d’autres termes, littéraires ceux-là, la solitude n’est pas contenue dans le cri qui l’exprime, mais dans le corps qui le pousse dans le monde. Il a fallu que ce corps ait un sexe, il a même fallu qu’il demeure à jamais impossible qu’il n’en ait pas, l’idée même d’un corps sans sexe est aussi inconcevable, par la raison textuelle, que l’infini qui menace le texte de son utilité, laquelle se confond, en pratique, avec sa probabilité. Pas facile dans ces conditions ici vite, trop vite exprimées, de mettre en présence la créativité, qui est un pouvoir, avec le sexe donné d’avance comme acteur. Ainsi posée, la question en est une qui concerne la collectivité, ou la somme des collectivités qui n’en est pas une, de collectivité. On risque de se perdre en conjectures, alors que la pratique du personnage, singée outrageusement par les religions, et non pas l’inverse, tendrait plutôt à démontrer que la différence réside dans la poésie qui émane du texte, et non pas des organes qui y répandent leur odeur d’enzymes. Et comme si cela ne suffisait pas, à complexifier tout propos tenu sur le sujet, nous n’avons pas le choix et même si nous l’avions, il serait limité à l’homme et à la femme, ou à l’aberration qui elle-même se limite à la même alternative. S’il est encore possible, par le biais du délire composé, de se croire à la fois homme et femme, ce n’est que par le jeu des apparences, ce n’est qu’un rôle de composition, encore alimenté par des lois d’ensemble. Mais limiter la question à ses influences d’homme et de femme, en acceptant toutes les aberrations constatées par la clinique ou simplement imaginables, ne revient guère qu’à fractionner de la manière la plus simple un territoire de la pensée qui n’a encore rien décidé, malgré l’Histoire et ce Futur qui ne contient rien que la suite. On se planterait devant le tableau pour essayer de deviner s’il a été peint par un homme ou par une femme, accessoirement on se demanderait si cet homme en est un ou si cette femme n’est pas un homme. À ce jeu de devinette, qui doit cacher bien des superstitions, on ne gagne que l’estime de soi ou quelque vexation qu’il faudrait prendre alors en considération pour donner à estimer le peu d’homme ou de femme, selon le cas, que l’artiste a mis dans l’oeuvre exposée au regard considéré comme un moyen de savoir ce qui d’ailleurs n’est peut-être pas ici en cause. La confusion limite assez heureusement ce genre de prospection à des syllogismes spécieux, du type :
- Ce texte est une création ; - Il est écrit par une femme ; - Donc, la femme crée.
Ou pire :
- La femme crée ; - Son texte est une création ; - Donc, elle existe en tant que femme.
C’est là faire oeuvre d’imagination, qui n’est certes pas négligeable, mais ce n’est pas une solution. Car on en viendrait à limiter la création de la femme à la femme, et celle de l’homme à l’homme. Conséquemment, une aberration demeurerait une aberration, sans possibilité de repentir ou mieux d’exagération. L’homme créé par la femme serait impensable, alors qu’elle lui donne le jour sans problème ; et inversement, la femme créée par l’homme, qui ne lui donne jamais le jour, relèverait de la marionnette agitée par le désir. On irait jusqu’à affirmer que la douleur n’est pas la même, qu’elle est spécifique, et qu’on ne communique vraiment qu’entre personnes du même sexe, ce qui ajoute de l’eau au moulin des homosexualités sans éclairer jamais le propos initial. Cependant, et comme toute l’Histoire en témoigne, l’homme s’est toujours emparé du pouvoir de créer plus facilement que la femme. Il a même créé Dieu à son image et réduit la femme à une vierge incroyable, une putain repentie ou une vieille lubrique qui justifie assez pleinement la polygamie. Il ne serait pas venu à l’idée d’un Romain de placer Junon au dessus de Jupiter pas plus que d’attribuer aussi arbitrairement des grossesses à ce Dieu qui n’est que de l’homme porté aux nues. Le pouvoir créatif de la femme, encore de nos jours, s’en est trouvé diminué quand il n’a pas été, quand il n’est pas tout simplement annulé, interdit, ou détruit. De ce combat voulu par l’homme, parce qu’il est en lutte contre l’homme, il ressort en effet que l’homme est plus créatif que la femme. Du moins a-t-il été et est-il toujours plus productif. Une analyse plus précise démontrerait sans problème que ce surcroît de production n’est en rien un gage de qualité supérieure. Il n’en reste pas moins que c’est de ce combat perpétuellement perdu que la femme tire sa substance à créer. L’homme n’y peut rien, même s’il est lui-même en dessous de l’homme pour des raisons plus historiques. Cette différence incalculable et obligatoirement estimable est à la racine de la création féminine. La révolte en est changée. La femme est souvent créatrice dans le refus alors que l’homme préfère l’invention. La femme demeure là où l’homme prétend changer le monde et par conséquent la femme. Ici, l’homme se passerait volontiers de la femme si celle-ci ne lui était pas donnée. Or, tout concourt à la lui donner. Il n’est donc pas étonnant qu’il ne change pas, pas étonnant que l’Histoire renvoie toujours son image d’homme sans jamais éclairer sa nature d’existence précaire. Son combat ne peut pas se trouver à la racine du mal, par définition. Il surnage. Cette eau, c’est évident, c’est la femme. Toutes les mythologies la reconnaissent. De ce point de vue, il apparaît en effet que la femme ne crée pas ce que l’homme crée de son côté. Et cela ne tient qu’à la profondeur que l’homme lui impose comme demeure. Elle est enfouie par l’homme. Et l’homme du commun passe une bonne partie de son temps à enfouir la femme. Elle ne peut être qu’occupée à s’en sortir, sortir de l’homme. Mais ce ne sont là que des sensations d’homme qui tente vainement de se mettre à la place de la femme pour deviner ce qu’elle endure. Ce passage de la femme dans le texte n’est pas au commencement du texte, loin de là. Il se peut que ce ne soit qu’un épisode sans importance. Une passade. Or, quand je me relis, je constate avec effroi que je n’imagine jamais que la femme puisse elle aussi tenter de se mettre à la place de l’homme pour le vaincre. Je ne prends jamais ce chemin, sans doute parce qu’il ne m’est pas donné. La femme que je crée n’est jamais un homme. Par contre, les hommes que je crée sont souvent des créateurs de femmes. Je ne vais pas ici entrer dans des considérations psychologiques sans doute étrangères au texte que je promeus pour exister différemment des autres hommes. Il me semble même que je m’éloigne significativement de la psychologie littéraire qui typifie au lieu de multiplier comme c’est l’enjeu de toute science. Je prends le risque de me perdre et de perdre le peu de lecteur qui me reste. La poésie elle-même perd de la poésie au profit du roman qui ne gagne pas à être un roman. Je sais tout cela. Mais au-delà de la femme, c’est le personnage incréé qui m’attend et j’ai ma petite idée là-dessus.
Le portrait de l’artiste dans sa jeunesse forme sans doute le lit de la littérature moderne. Replacer ainsi l’enfance, après coup, dans son contexte historique et géographique est une manière d’affirmer sa différence, car rien n’est plus ressemblant à un adulte qu’un autre adulte, ou du moins les différences entre adultes sont si infimes, d’un point de vue ressemblance, que les héros finissent toujours par se distinguer seulement du fond qui sert d’itinéraire à leur voyage. À l’âge adulte, sauf exception, le sexe est joué sur le mode du non-retour, il n’a pas d’autre avenir que la reproduction et le plaisir codifié. Tandis que l’enfant est sur le point de devenir, mais il n’existe que parce qu’il est un enfant. Un adulte ne peut pas en dire autant, lui qui joue au sexe ou plus exactement avec les deux faces du sexe qu’il est somme toute assez facile de proposer à l’imagination et au raisonnement. Il se trouve toujours un enfant pour distinguer des particularités du langage qui l’autorisent à, si l’on veut, traverser le miroir. L’analogie, l’harmonie, le contraste titillent son intelligence qui est encore la partie visible d’un iceberg qui deviendra, à la force du poignet, une île dans un océan d’impostures et de contraintes avec lesquelles c’est la manière de compromis qui particularise l’artiste et rejette, à ses yeux, l’homme du commun dans les marges de l’existence conçue comme une résistance au monde. Soit. Je viens de bourrer ce paragraphe de références toutes littéraires : Artaud (Lettre de ménage), Musil, Joyce, Faulkner, Hemingway... Ce n’est pas en vain que l’enfant est déjà un artiste. Ses lectures catalysent ses impressions et ses premières compositions. Ni homme, ni femme, soumis, dès la myélinisation, à des approches physiques, athlétiques, de son sexe encore incertain quant à sa destination, ses essais convainquent rarement, inquiètent le plus souvent, et quelquefois le conduisent dans les corridors de l’interdit où, me semble-t-il, ce sont la famille et la patrie qui imposent leurs lois. Il suffit que le rêve soit brisé et l’enfant est mûr comme le fruit. À moins d’un suicide, son avenir ne lui appartient pas. J’ai tenté quelque part de raconter ce passage de la réalité à l’imposture. Un enfant se suicide ; son futur disparaît ; demeure son maigre passé et cet instant, juste avant la mort, où il a joué, par l’imagination, avec son futur d’homme de peine, de factotum, de valet de pied. "Et dès cet instant, je n’ai plus su si j’étais une fille ou un garçon, car cela n’avait plus aucune espèce d’importance." Et cela s’explique par cette autre conception de la virginité où le corps possède encore pleinement cette possibilité de disparaître sans laisser de traces. Il a suffi d’un combat pour que le suicide se propose à l’esprit et que le présent disparaisse lui aussi au profit d’un partage très net de l’existence en passé et en futur. Le récit n’est que cela : passé et futur. Et le personnage à portraiturer a vécu cela : pendant un court instant cosmique, il a cessé d’exister pour n’être plus que sa mémoire et son imagination. Toute littérature marquée par le présent devient alors une imposture, mystification ou snobisme, peu importe, les choses ont désormais acquis cette indicible clarté par quoi les hommes sont des hommes. Dans ces conditions peut-être extrêmes (sait-on ?), la vision de l’autre sexe, après le suicide manqué ou interrompu, remis à plus tard (mais dans quel autre combat ?), n’est plus marquée par l’idée de mariage, mais par celle de ressemblance. L’homme et la femme qui créent se ressemblent, il y a entre eux une ressemblance qui est aussi un signe de reconnaissance. Et peu importe qui est l’homme et qui est la femme. L’enfant qui a été et qui n’est plus revient à la surface et gare alors à ceux qui cherchent à expliquer le présent en guise de narration. De narration, il n’y a que ce passé et ce futur, un passé qui s’interpose entre l’apparition et le paroxysme de la résistance, et un futur qui en un instant de foudroyante imagination a traversé la mort possible comme un personnage. Il y a donc créateur et créateur. Si l’on veut considérer, comme le pense le scientifique, que le créateur est indifféremment homme ou femme, ange ou assassin, poète ou politique, etc., alors on s’éloigne du récit pour se livrer à une classification qui fera de l’artiste un cas particulier. Cette réduction au modèle confinera inévitablement à la biographie, voire à l’autobiographie si l’écrivain, par exemple, a quelques velléités d’homme de science. Or, Joyce utilise le mot portrait, qui appartient aux arts plastiques et à la psychologie littéraire et de plus près au théâtre vers lequel toute son oeuvre se projette. Le récit n’est donc pas une autobiographie. L’intituler Dedalus est une sottise qui justement tire le portrait vers l’autobiographie, supercherie commerciale qui dénature le texte par le haut, la phase suivante consistant à commenter le texte lui-même pour pallier ses défauts. La sottise des exégètes, ajoutée à l’orgueil des éditeurs et à la soif des lecteurs, impose une traversée des apparences aussi proche que possible du combat livré naguère au miroir des réalités. L’enfant, en soi, n’est donc pas mort. Il a survécu autant à ses jeux-partages qu’à sa mort-récit. Il est devenu adulte sans cesser d’être un artiste. Il a acquis une telle volonté d’existence qu’il est capable de pauvreté comme repoussoir de la mort. À ce moment, le sexe est prépondérant. Il ne le serait pas devenu si l’enfant était mort l’instant d’après son imagination. Joyce situe la fin de la jeunesse au moment d’une apparition prometteuse. Nul doute que cet instant a été vécu. Tout le monde connaît ce passage à la fin du Portrait :
Une jeune fille se tenait devant lui, debout dans le ruisseau, - seule et tranquille, regardant vers le large. (fin de l’avant-dernier chapitre)
Ce pourrait être un jeune homme, ce pourraient être deux jeunes hommes ou deux jeunes filles - l’amour-désir n’a pas de fin aussi définitive que les préceptes de la bonne morale associée à la paix sociale. La question n’est pas là. Deux cas peuvent se présenter :
- ces deux êtres sont deux artistes, et alors nous aurons deux versions ; - l’un est un artiste et l’autre ne l’est pas ; le texte (par exemple) reposera sur le lit des traces biographiques laissées par l’existence et ses voyages.
Dans le cas de Joyce, la femme est à la fois désirable et capable de donner le plaisir. Elle est inculte, pas du tout artiste. Ce qui donne par exemple ce dialogue :
RICHARD. Bertha ! (elle ne répond pas) Bertha, tu es libre ! BERTHA. (elle le repousse) Ne me touche pas ! Tu es un étranger pour moi. Tu ne peux pas comprendre ce qui se passe dans mon coeur. Un étranger ! Je vis avec un étranger ! (Les exilés)
Nous ne savons pas ce que Joyce pensait de Djuna Barnes, qui l’égalait sur le terrain des possibilités littéraires et dramatiques. Mais on sait que Barnes se rapprochait de Joyce par la trajectoire du texte d’un bout de la vie à l’autre, et que Joyce lui témoignait un silence sans doute chargé d’estime. Et c’est peut-être ce qu’il aurait vécu, ce silence, s’il avait partagé son existence avec une artiste de l’importance de Djuna Barnes. Mais tout ceci est vaine spéculation. L’imaginaire qui sourd de la jeunesse est un volcan d’imprécations et de révoltes. Deux lourds pavés, chacun à leur manière, ont imposé leurs possibilités à une littérature universelle qui en est marquée à tout jamais. En tout cas, chez Joyce, la femme ne crée pas autre chose que le monde, ce qui ne semble pas, à ses yeux, relever d’une douleur artistique, pas même par analogie (la rivière). La question n’étant toujours pas là.
Il s’agirait plutôt d’une supplique : qui suis-je ? Ce qui, dans le cerveau de l’enfant, se traduit par : qui serai-je ? Ne pas trouver la réponse à cette question d’angoisse pure, c’est condamner l’enfant, celui qu’on est à cet instant ou celui qui se présente à l’esprit au moment de le retrouver chez l’autre. Si l’être à venir ne se profile pas nettement ou s’il ne promet que la ressemblance, la question est celle du suicide, mais d’un suicide qui ne doit rien à l’absurde ni au désespoir. Seulement à l’angoisse. Un tel enfant, s’il existait, détiendrait le pouvoir de se détruire pour une raison parfaitement claire. La réalité rencontre plutôt un récit confus qui est comme une avancée précaire dans le roman qu’une existence difficile rend désormais possible. Que cet enfant se distingue alors par l’érection d’un pénis ou la turgescence d’un clitoris n’a aucune importance vitale. Mais que la distinction vienne du dehors, qu’elle s’impose à l’action, qu’elle impose ses principes étrangers à une connaissance de soi déjà profonde et presque cohérente, alors le récit change de sujet, ou au moins se laisse-t-il pénétrer par des influences qui réclament l’adhésion, voire la soumission, pourquoi pas l’abandon pur et simple. Certes, nul artiste n’est assez fou pour se croire capable de retrouver cet instant qui, décidément, n’est pas une madeleine. Il faut dire que chaque fois que l’esprit se méfie de l’intelligence, au point quelquefois de ne plus rien exiger d’elle, et c’est le cas de Proust si je ne m’abuse, la mémoire prend toute la place (mais quelle place, la place de quoi ?) pour proposer ses épanchements, ou plus exactement son expansion géométrique spatiale au sein même du langage en question. De temps, il n’en existe qu’un : le temps présent, celui qui donne la conscience d’un écoulement, d’une durée, croissant à l’instant dans la condamnation à ne plus rien changer de ce qui n’est plus présent et poussant l’esprit à se croire investi du pouvoir de prédire ou mieux de projeter. Je me demande encore ce qu’il reste de la Recherche une fois dépouillée de ses décors d’époque et de ses nostalgies familiales et territoriales. Nulle part dans ce texte infini, et qui vaut d’ailleurs par son infini et non pas par ses qualités littéraires, l’enfant ne paraît tel qu’il fut au moment de n’être plus ce qu’il est encore pour un instant. Tout bien pesé, le projet de la Recherche est si vague qu’on ne peut guère l’exprimer qu’avec les moyens colossaux que Proust impose encore à l’esprit à l’ouvrage d’un roman. Sainte-Beuve revient toujours. Mais je laisse là ce sujet, car c’en est un autre. L’artiste ni homme, ni femme, ni hybride. L’artiste connaît l’instant qui fait de lui ou d’elle un homme, une femme, ou follement un hybride. La jeune fille qui arrête Dedalus à proximité d’un ruisseau s’installe à la place du temps, à jamais. Tout se décide à cet autre instant. Elle, la mort, ou, dans le cas de Joyce, la défroque du prêtre promis à la chasteté qui est en effet la seule réponse probante à la question du sexe. Mais c’est une réponse qui interdit la poésie (je pense à L’approbaniste d’André Billy). Le dogme religieux, le plus souvent bête et méchant, confinant inévitablement à l’horreur, quand il permet une poésie ou un comportement presque iconoclaste (Teresa, San Juan de la Cruz - les deux sardines en croix de ses réclusions - sainte Brigitte la pouliche, Salomon l’Écclésiaste, etc.), n’est que très rarement, pour l’artiste, une vocation. Ce n’est qu’une manière de tuer en soi l’artiste qui menace l’enfant de simonie. Dedalus choisit la femme et l’art. Il choisit une femme qui (dit Bertha dans Les exilés) fait de lui un homme. Elle est idiote et belle. Une solution d’attente. Et la légende veut que Joyce ait crié son nom juste avant de rendre le dernier soupir. Au fond, le sexe, c’est celui de l’autre. C’est l’autre qui prend la place de l’enfant si la mort n’a pas mis fin à cette cohérence invivable autrement que par des moyens artistiques. Que Nora ait accepté la pauvreté, qu’elle ait plongé ses mains dans le feu où Stephen le héros achevait son existence de manuscrit inachevable autrement, qu’elle ait été promise ou pas, par Joyce lui-même, à un autre homme (autrement dit, que Les exilés retienne quelque chose de précisément biographique), tout cela est contenu dans le texte à la manière de Proust, au fil d’un récit qui n’est plus celui de l’enfant, mais ce que l’adulte peut encore seringuer dans les draps de son attente. La poésie, l’art au fond, persiste en filigrane. Il faut la chercher. Et c’est là ce qui distingue Joyce de Proust : cette recherche qui n’existe pas chez Proust trop enclin à mettre en scène alors que le théâtre de Joyce est capable de changer la langue sans perdre de vue la littérature, évidence d’un instinct littéraire qui, chez Proust, est remplacé par la reconnaissance des bons moyens. Ceci pour dire, et je rejoins Jean-Sol Patre sur ce terrain glissant, que le masque d’Albertine est, plus qu’une erreur, un manque de métier. L’excuse de la discrétion, Gide n’a pas vu d’inconvénient à s’en passer dans son Corydon. Alors ? Il serait tout de même inacceptable qu’on ait, à ce moment solennel de mon existence, décidé à ma place de mon sexe et de son utilisation. Je préfère, et de loin, penser que mon choix d’être un homme relève du pur instinct, que je n’ai pas pu choisir d’être femme parce que je me sentais homme et que la femme m’attirait sexuellement. J’avoue que mon plaisir serait gravement atteint si ma science du récit me révélait un jour que ma nature d’homme doit ne serait-ce qu’un rien à l’influence des autres. Je ne désire pas, je ne me suis jamais senti désirer être un homme uniquement parce qu’on me le demandait. Mon texte, en l’état actuel, me souffle discrètement que je suis un homme d’instinct. Certes, j’ai toujours su, et c’est là l’épicentre de ma révolte, que je ne pouvais être ni prince, ni sergent. Je veux dire que je n’ai jamais souhaité commander aux autres, me situer au-dessus d’eux pour les plier à la volonté d’une puissance supérieure, et que je n’ai pas non plus rêvé à ce luxe incroyable, dont jouissent nos princes, qu’ils soient originaires de l’Occident ou d’ailleurs, qui permet de ou qui consiste à dépenser sans compter, ou bien seulement compter avec un calculateur puissant. J’ai bien senti, dès le départ, que l’exercice de l’autorité et la pratique de l’achat auraient sur mon art une aussi mauvaise influence que les idées religieuses et autres traditions de la structure. Je suis donc un homme pauvre, ce qui curieusement ne m’empêche pas de pratiquer mon art, sinon avec talent, du moins avec bonheur, ce qui m’enchante toujours au fond. Mais ces considérations de surface, si exactes sont-elles, ne doivent pas cacher dans leur broussaille la réalité d’un choix beaucoup plus complexe que le laisserait supposer l’instinct soi-disant trouvé ici et ailleurs dans le texte et la geste quotidienne. S’il a toujours été clair en effet que je ferais tout pour n’être ni sergent, ni prince (ce qui n’est pas bien difficile donc), pourquoi ne pas reconnaître que le choix de l’homme est opaque, et que la femme que je suis demeure comme l’attente, sans doute prête à se manifester si l’occasion se présente, occasion marquée en ce qui me concerne par le texte (en dehors de toute considération de genre), autrement dit presque quotidiennement et au-dessus de toutes mes autres activités existentielles. Je ne doute même pas que l’assistance à la dissection de cadavres, belle expérience de l’immobilité de l’autre, suivie immédiatement du recours au schéma tragiquement plus précis et évocateur, ait exercé sur moi des influences claires. Un pénis et un clitoris, - je veux dire le clitoris révélé par son extraction et non pas par ce que la pratique de la caresse connaît ou reconnaît -, l’effet de miroir appliqué à l’un ou l’autre organe urinogénital, la similitude physique une fois le sexe réduit à son graphique explicatif, à ses transes cognitives, ces explorations ont sans doute agi sur ma pensée, comme les bornes à atteindre pour demeurer encore compréhensible et crédible. Il semble que ces deux corps si semblables n’aient été conçus, au hasard d’une nature qui naît elle-même d’autres principes dont le génie nous échappe ou nous est étranger, que pour se reproduire par imbrication, alors qu’il eut été plus simple, comme les oursins et les fleurs, de confier nos semences au vent ou au diable. Les fleurs ne s’aiment pas, mais elles sont enracinées. Et ce n’est que leur apparence et leur fragrance qui s’interposent entre les uns et les autres, ce qui détruit toute velléité analogique, non ? Alors ne soyons pas chiens au point de ne pas reconnaître que ce n’est pas l’enfant qui est en jeu, ni même ce qu’il est devenu, puisqu’il ne devient pas : il n’est plus. Ce qui est, c’est l’homme, et ce qu’il contient d’influences, d’instinct, de possibilités. Un artiste qui simplifierait sa vie jusqu’à n’être qu’un lui-même, et il n’en manque pas dans les écuries éditoriales, travaillerait beaucoup plus à effacer les traces de sa complexité sexuelle qu’à établir le texte de son roman populaire. Vraisemblablement, pour s’en tenir à la passion racinienne, personne ne peut prétendre à l’un ou l’autre sexe à l’intérieur de son oeuvre. Le sexe est donné, sans qu’il soit possible de dire si c’est l’instinct qui se charge de ce travail de fond, ou si l’influence des autres est déterminante. Le choix de Nora ne conclut pas la poussée de l’enfance par une extase insoupçonnable. Le choix initial (Nora ou autre) ne peut pas imposer ses luttes à un texte qui y est étranger par nature. Je suis un homme qui écrit ne veut pas dire que la femme est en dehors de moi. Je ne peux même pas la réduire à une hypothèse qui imposerait d’ailleurs une rhétorique à une cheire verbale qui n’en veut pas.
À la question Qui suis-je ou qui serai-je ? il faut donc répondre par une autre question : m’est-il possible de créer le personnage femme qui appartient à mon récit ? M’est-il donné de le créer sans sacrifier à l’interprétation qui guette le récit dès que la femme personnage s’interpose entre l’écriture et l’effet ? Qui suis-je, au fond, pour prétendre créer ce que je ne suis pas ou ce que je ne suis que par intermittence ? Parler de la femme, cela suffit-il à la créer ? Mes personnages ne sont-ils pas tous des hommes ? Ne sont-ils pas tous moi-même ? Ne sont-ils pas les rôles que je ne joue pas quand je suis moi-même ? Etc. On ne répond pas à ce genre de questions par l’essai. On n’y répond pas vraiment en écrivant le récit qui devient, on ne sait pourquoi avec certitude, roman ou poème. L’exercice du récit réduit le champ de la pensée, celle qui s’exerce au fil de la narration, à la pratique du personnage incréé. Et si cette souffrance confine à soi, description du personnage homme surpris ou invité à créer, l’opacité du récit, d’abord simple voile à scinder pour parler enfin aux autres de ce qui les concerne ensemble, devient une transparence infranchissable, un lieu d’où il est possible de s’observer et d’observer les autres, mais sans pouvoir en parler utilement. Personne, véritable auteur de tout ce qui apparaît nettement comme création artistique, ne peut affirmer qu’il sait quelque chose d’incontestablement durable s’il n’a pas résolu la question de son sexe. Le personnage est un pont jeté par-dessus le néant qui est la preuve que la mort est bel et bien une destruction définitive et qu’il n’y a pas lieu de croire qu’il en est autrement. D’ailleurs, tout ce qui réduit la pensée à la doctrine ou au sacré ne voit aucun inconvénient à déterminer le sexe de chacun, arbitrairement et d’autorité, à ce que l’aspect donne à voir et à voir fonctionner. L’artiste commence son existence de paria en ne décidant rien à la place des autres. Il ne propose que sa substance, pas son existence. S’il franchit la limite imposée par sa possibilité, il devient un artisan de la pensée des autres, il se soumet à des ensembles agissant sur les autres, il n’est plus en mesure de pratiquer le personnage. Mais si l’on comprend et si l’on accepte aisément que l’artisan donne à voir et à appréhender le personnage typé des fables communes, on rejette toujours les approches de l’artiste tant son personnage est impensable. Il n’y a pas de littérature populaire sans rhétorique. Le personnage y est décrit, on le reconnaît, il participe à une action dont le temps est mesurable, il fait partie de la conclusion, ou plus exactement la conclusion ne peut pas exister sans lui. On appelle cela, généralement, de la cohérence, c’est-à-dire un mélange de lisibilité et de probabilité. Plus c’est lisible, et plus c’est probable. On en tire un peu vite la leçon d’une illisibilité qui ne serait plus du tout probable. On sent bien alors que ce genre d’écrit ou d’oeuvre est un coup de dés, sans toutefois pousser la réflexion jusqu’à prévoir le hasard où la pensée vient, de s’égarer pour les uns, d’exister pour les autres. Ces questions peuvent paraître de pures extravagances de l’esprit en mal de cohérence et de recherches sensées. Mais l’artiste en tire facilement quelques hypothèses qu’il ne lui est pas possible raisonnablement de négliger quant à la conduite de son récit :
- le personnage homme est possible par ressemblance ; - le personnage femme est une aventure ; - le sexe du personnage est un coup de dés ; - le nom du personnage est, sinon incertain, du moins variable.
Portrait, récit, langage, texte. Instances joyciennes dont le texte, finalement, est un théâtre, vrai lieu des coexistences exemplaires et de son habitabilité (demeure). Je ne sais d’ailleurs pas si, femme au lieu d’être homme, la dramaturgie se présenterait de la même façon et, comme créateur du personnage femme créatrice, je dois imaginer ce qu’il en serait alors de ces instances :
- le personnage femme me ressemble-t-il toujours ? - le personnage homme mérite-t-il cette aventure que je lui propose ? - le sexe du personnage relève-t-il encore d’une pratique du hasard par dés interposés ? - que sais-je des uns et des autres si je ne connais pas leurs noms réciproques ?
C’est là pure imagination, mais imagination en quête de solutions. Et cela suppose une infinité de variations textuelles où mon personnage femme créatrice finit par se noyer : trop d’hypothèses confinent à une illisibilité qui n’est plus celle de l’inconscient, mais celle d’une pratique exagérée, monumentale, invitant à l’exaspération malgré de bons moments presque tous, d’ailleurs, lyriques. En tout cas, en mettant en scène le personnage femme créatrice, je ne réponds pas par avance à ces deux questions lancinantes :
- est-ce une femme ? - est-ce une créatrice ?
J’y répondrais sans doute plus clairement, à défaut de le faire parfaitement, si elle n’était pas créatrice, si elle manquait à devenir la femme que je contiens. Mais si elle n’est plus créatrice, je deviens l’anagnoste d’un bovarysme sans Flaubert, simple lecteur de l’évidence une fois les dés jetés et la parole condamnée à la redite. Si, par hypothèse de poids faible, je consacre le récit au personnage homme créateur (comme je l’ai fait par exemple dans Coq à l’âne Cocaïne) sans au moins évoquer par principe la femme qui l’influence de l’intérieur, je ne suis plus écrivain, je suis un perroquet, un imitateur, un singe, une marionnette, un artisan à la petite semaine, voire un amuseur public si la chance me sourit. Or, si j’écris pour être lu, je ne veux pas être lu à la condition de ne pas écrire. Et tandis que Joyce (qu’on remplacera avantageusement par Stein si l’on désire aller plus loin) modifie le bovarysme par souci de rendu réaliste, je m’en distingue pour ne pas sombrer dans la continuation et prendre le risque de ne pondre finalement qu’un sous-produit qui ne me récompenserait pas de n’avoir pas écrit quelque chose de complètement raté.
Depuis la publication des pages perdues de Madame Bovary, le mouvement de sympathie semble s’être déplacé de l’amant ou ami au mari ou cocu. Ce déplacement devient plus rigoureux avec la croissance graduelle d’un réalisme collectif pratique dû aux changements des conditions économiques* de la masse de ceux qui sont invités à écouter et à apprécier une oeuvre d’art en phase avec leur existence. James Joyce - Notes sur Les exilés, oeuvre comique, dit-il avec justesse. *Importance de l’économie dans la pensée de Mallarmé - autres pages perdues (note de l’auteur).
Le but d’un essai n’étant pas de résoudre toutes les questions par des réponses mais plutôt de promouvoir leur pertinence à la manière d’un poème de Vigny, je passe allégrement (je ne le cache pas) par dessus leur écheveau pour revenir au sujet de la présente disputation. Il est temps maintenant de renvoyer au texte, ou plus exactement aux textes qui constituent ma réponse palpable. |
|||
|
|
|
Revue d'Art et de Littérature, Musique - Espaces d'auteurs | [Contact e-mail] |